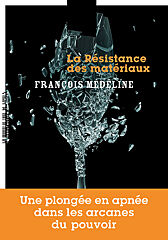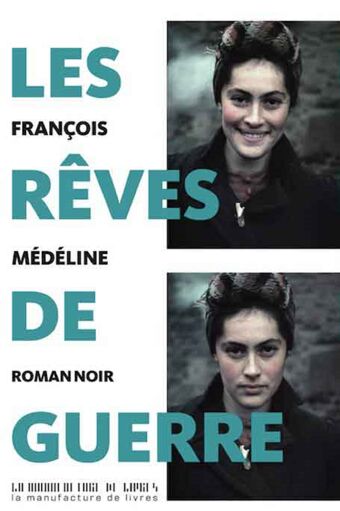
François Médéline
Les Rêves de guerre
Michel Molina est capitaine au service criminel du SRPJ de Lyon. Le mur de Berlin tombe. Lui navigue entre son quartier populaire de la Saulaie, les homicides dans les cités qui s’embrasent et un sentiment de culpabilité qui remonte à trop loin. Quand il reçoit le message d’un mystérieux corbeau, vingt ans après l’assassinat de son meilleur ami, ce sont tous les non-dits de son enfance qui explosent : son père qu’il n’a jamais vraiment connu, son frère qui se planque en Colombie et tourne de la coke pour Pablo Escobar, sa sainte mère, Natacha. Molina embarque son second, le lieutenant Grubin, dans une CX break et file au bord du lac Léman, là où sont noyés tous ses secrets. Mais le corbeau rôde et il doit chercher bien plus loin, jusqu’au camp de Mauthausen construit par les Baukommandos, ces milliers de républicains espagnols qui ont perdu jusqu’à la vie.
Roman policier autant que récit initiatique sur les interdits de l’amour, Les Rêves de guerre interroge les mécanismes qui ont conduit à appliquer à l’extermination de masse la puissance de la rationalité, moteur de la civilisation occidentale.
- En deux romans et autant de claques, François Médéline impose son style et ses obsessions. Grandiose !Il y a du Ellroy, mais surtout du talent, dans ce second roman de Médéline. Le talent des géants, celui capable d’offrir un roman exigeant qui vous renvoie un plaisir de lecture rare. Je salue le travail d’orfèvre impeccable de construction, la puissance de l’histoire, le verbe qui raisonne. Inoubliable, à faire tourner.Une atmosphère envoûtante, empreinte d’une poésie qui se fait parfois lyrique et qui n’est pas sans rappeler l’œuvre de David Peace. Écrivain total qui met ses tripes sur le table François Médéline fait indubitablement partie de l’avant-garde du roman noir français, et ses puissants Rêves de guerre resteront longtemps gravés dans la mémoire de ses lecteurs.
- téléchargez l’extrait
Strengen (Autriche) – 21 mars 1944
Paco disait [en français] :
- Fais-le, fais-moi ce que tu lui as fait.
C’était depuis Mauthausen. Elle est sortie du bloc numéro un dans un sac. Eda-la-SS a coûté treize dents dedans : huit molaires. Elle est entrée dans la caisse en bois sous le camion. Avec moi, Paco. L’Autrichien du garage a coûté dix paquets de Zora, à l’unité. Le Luger a coûté sept dents de plus. Eda-la-SS a coûté treize dents dehors : neuf molaires. Des dents espagnoles, russes, des molaires juives, des dents en or. Des dents qu’il a arrachées des gencives avant le crématorium, après la chambre à gaz, après les pendaisons dans la grande cour, après le voyage dans la charrette des morts, après Gusen, quand elles tombaient du camion bleu, le gros Magirus-Deutz, les corps se brisaient sur la remorque, les ongles saignaient le métal, les hurlements plombaient le jour, le brouillard, les dents qui sentaient le gaz d’échappement, qui brillaient, au loin, l’or de notre avenir, l’or que Paco a planqué dans son cul, dent par dent, corps après corps, nos graines du printemps. Leur agonie était notre avenir, c’était de la chair pour qu’on devienne des hommes.
Eda-la-SS ferme les yeux. Elle a posé la main sur la crosse de son arme, contre sa fesse, à gauche. Le camion, les grilles, on s’est éloigné de la forteresse, le grand aigle nous regarde partir, les ailes déployées, ces grandes ailes qui dominent les champs, la ville et le monde.Paco a répété [en français] :
- Fais-le, fais-moi ce que tu lui as fait.
C’était depuis Mauthausen. Juan-Manuel a nagé, couru, rampé, beaucoup. Cours, cours, cours : les pieds, les ampoules, les galoches, la brûlure, les semelles de bois, les coupures, la voûte plantaire, les plaies, les orteils : à vif. La terre le sang le ciel : la trinité. Le camion bleu. Juan-Manuel a mis six coups de marteau dans la tête du SS, un pieu dans l’œil du SS, il a tranché la gorge du conducteur avec un couteau. Le sang, du sang chaud, du sang de blond qui chauffait les doigts. Il a ouvert la caisse sous le camion. L’air est entré, il a brûlé, là, dedans les thorax, elle hurle. Il a ouvert les portes du camion. Le nuage s’est envolé sur les arbres, vers les collines, les fleurs, l’herbe des prairies. Douze Espagnols du kommando de la carrière dégringolent sur le chemin. Les vingt-sept autres étaient morts. Paco les avait sélectionnés. Parmi les pires, les plus inutiles, les plus malades, les plus maigres, parmi les plus infectés, les plus faibles, les plus dysentériques, les plus finis. Des sauterelles bleues, des sauterelles bleues qui sautillent, avec des corps plus fins que les pattes, au milieu de rots de fumée. Ils ont disparu. Il est parti vers le sud. Avec moi, Paco. Avec elle, la Française. Paco ne le quittait pas mais il était seul. Avec elle. Paco a toujours été là, toujours, c’est Paco, sangsue comme une ombre, brave sous les balles qui sifflaient sur les flancs des montagnes pelées à Ronda la Vieja, sous les obus à glacer le soleil, brave à Barcarès, parqués comme des porcs nous-les-rouges, à voler leurs auges aux enfants, à rationner leurs rations, avec les pleurs, le marché noir, vérolé par les sentiments le Paco et toujours là, parce que son corps cherchait sa tête et sa destinée, parce qu’un corps a le courage des salopards, de ceux qui vivent en buvant jusqu’à leur propre sang.
Le ciel semblait haut et noir, le gros nuage bas et gris : avec la lumière, la lune qui perce, disparaît, l’embrase : le bois, les arbres, comme là-bas, les troncs crèvent d’être debout. Le Capital, c’est de la merde. Là-bas, les livres, là-bas, derrière les baraques, les rouges, dans les baraques, là-bas-aux-blocs, les Juifs bouffaient du charbon comme les rouges, les R, les SU, les P, comme les pédés, triangles roses, comme les triangles bleus : nous les fiers Espagnols, la chiasse, c’est du temps perdu, tu pouvais tuer pour ça, tuer les autres, les animaux, nous-les-autres, les rouges bouffaient du charbon comme les Juifs, triangle jaune, vers le ciel : l’azur, la sève, le sang. L’Internationale, c’est de la merde. Les livres qui restent c’était du papier : ils servaient pour essuyer les toiles rêches et pleines de merde, pour se coller aux omoplates, l’hiver, en cachette, sous la neige, dans la carrière, dans le gel, sur les marches, l’escalier de la mort, les livres, Cervantès et tout, Federico García Lorca, el crimen fué en Granada mais le crime est partout, tout, les mots, l’âme, tout ce qu’on a entré dans les têtes depuis des millénaires, sol-la-si-do-ré-mi c’est de la merde : les feuilles d’arbres sont grasses pendant la guerre. Filez-moi une cigarette, oubliez la lutte des classes, le prolétariat n’a qu’à périr comme la civilisation ; il surgit dans le fatras des courroies, des chaînes s’entremêlent, les turbines couinent ; moi faut que je vive : grâce à elle : avec elle : pour MOI.
Des pauvres, il en tombe tous les jours à la carrière, au revier, dans les baraques, les wagons, dans les tunnels, sur la route, à l’appel. Des numéros, des riches aussi, les riches tombaient vite, tous pauvres. Des centaines : chaque jour, tous les jours, depuis le premier et jusqu’au dernier, jusqu’aux volutes qui s’échappaient de la cheminée pour rejoindre le firmament de nos peines. Un riche pèse lourd, un pauvre pèse lourd, un Juif pèse lourd, un pédé pèse lourd, les Russes étaient grands, les Russes pesaient lourd. Faut les remonter de la carrière les enfin morts, les porter dès l’appel, faut monter ces marches, ces marches taillées avec nos mains, avec les miennes, pour ce granit noir qui est parti à Linz, qui part loin, pourquoi, pourquoi, comment on a creusé les tunnels, des marteaux humains, des burins humains, des hommes marteaux, des hommes burins, pour leurs usines, leurs engins à tuer, ils ont tué notre mort, ces sales Juifs, ces sales Russes, ces sales Tchèques, ces sales Polonais, sale race, ces sales morts. Lénine, c’est de la merde : Staline, c’est de la merde : ils lui en ont pris des milliers à Staline, des SU, des qui pèsent lourd, de longs zombies, chapelet de peau râpée, crânes rasés, mâchoires de singe, des milliers de pèlerins fantômes, sans plus rien dans la tête que de la bouillie, des zombies qui puent le désinfectant et la merde.Moi, je l’aime, la Française, ELLE, j’ai aimé ses yeux, j’ai aimé ses hanches osseuses, j’aime pénétrer dans son vagin graissé à la graisse de camion, là, sur la table en bois, sur la toile kaki, linceul de ses espérances, dans les limbes de la raison du bloc numéro un, pendant douze minutes, douze minutes, toujours pendant douze minutes, vers sept heures du soir, toujours : je l’aime moi, ma Française, j’aime sa fine peau claire.
Ils paient pour ça, pour son vagin gras et jeune.
Elle est là, dans la forêt, avec les violettes. C’est la guerre, pas de virevolte, ni de cabrioles, pas de bruissement, y’a plus de bruit depuis longtemps, y’a que le bruit des burins, des marteaux, des mâles, du sang qui gicle, des corps qui tombent, des blocs de granit, des wagons sur les rails, des roues de charrettes, des injections et des sifflements du revier, et la grande cheminée par où qu’ils sortiront tous, avec l’odeur âcre des porcs cramés, et les putains de SS avec leurs bottes, et l’Autrichien de la carrière, nazi décharné sanguinaire, et cette saloperie de chien à dévorer sur les ordres de sa saloperie de maître, où est le mendiant qu’il disait, le chien bouffait les cuisseaux, il a arraché les pénis, dévoré les visages, et les kapos, des verts, le sadique du bloc douze, et l’autre de Munich avec sa pipe en porcelaine, King Kong qui étrangle avec ses mains gigantesques, et des bleus aussi, fiers espagnols mon cul, bourreaux de la pire espèce, leurs bâtons, tape-tape-tape, leur schlague, leurs yeux, leurs yeux pleins et heureux, pendant qu’eux-autres, nous, on n’est plus là, on est debout, on sent la faim, la faim si tu veux de l’après, après, la vie : sale pute. Elle est là dans la forêt, avec les violettes. Là, elle pleure contre le tronc. La bouche, c’est sa bouche : les lèvres, ses lèvres. Y’avait sa bouche, y’avait ses lèvres. Elle a ouvert la bouche.
Paco insiste [en français] :
- Fais-le, fais-moi ce que tu lui as fait.Liszt, c’est de la merde.
Je dis le livre de feu
Tu liras le livre de feu, les pages qui brûlent
Maman ne lira pas,
Papa, écoute, écoute, papa,
Toi, moi, rêvons jusqu’à la lie
Nous enfantons les fous, des paradis
Et vous lirez parmi les flammes,
Rien que des morts, des clairs de lune17
1.
Dimanche 19 novembre 1989 – Solaize (Rhône)Au Bar de la mairie, on se foutait autant de la couleur du ciel que du mur de Berlin. Le rade était fermé devant, ouvert derrière, les gens entraient et sortaient par les terrains de boules en terre battue. Sur Europe, le chanteur des Fine Young Cannibals disait que la seule chose de bien dans sa vie avait disparu, hey hey hey. Ça plaisait aux deux gones qui jouaient au billard américain. Leurs copines avaient les yeux plus brillants que leurs bottines, des vestes flashy avec des oursons en strass, maxi seize, dix-sept ans. Elles buvaient des diabolos menthe, fumaient autant que nous. Robert et Janine servaient des babys de J & B aux trois forains du fond, des ballons de Côtes-du-Rhône aux papys, sauf au vieux qui en était à son sixième demi de Stella. Et à moi. Je sirotais un huitième Pastis, enfin, la dernière moitié du quatrième ; je buvais des momies, pas des entiers.
Le vieux m’a souri, il a mordillé son cigarillo, coupé le tas de cartes devant lui. Il fumait des Meccarillos, ceux avec la boîte en carton rouge et or. La consommation de tabac lui coûtait un bras qu’il ne dépensait pas en picole. Un lendemain de bringue, alors que je n’avais plus toute ma tête, je lui ai suggéré qu’il allait choper le crabe à ce rythme. Il m’a rétorqué que son gastro-entéro était d’autant plus ravi pour son foie que sa femme s’était barré avec un pneumologue. Il aurait pu me retourner le compliment mais le vieux est un marrant. Je l’ai vu mettre quatorze fois le but aux planches lors d’un concours de boules à Rive-de-Gier juste parce qu’il voulait se cogner Bernard Cheviet. Il se l’est cogné d’ailleurs, avant de laisser filer le tournoi contre une quadrette de Romans-sur-Isère.
On avait compilé les dernières avancées du dossier Abdelaziz Bouzade pendant la nuit pour faire plaisir à la substitut du proc. Cette fille me harcelait niveau paperasse, une pétasse de trente-deux ans qui pédalait sur un home-trainer entre midi et deux et ingérait du pain azyme. Elle n’avait sans doute pas compris qu’aucune formation de sténo n’était dispensée au Service Régional de la Police Judiciaire, que l’élément le plus efficace du groupe en la matière était le vieux, si on faisait abstraction de l’inspecteur Stéphanie Duverger qui savait tout faire et le faisait bien. Le vieux avait tapé sous ma dictée et sur son Olympia Traveller de luxe — une portative orange que son gosse lui avait offerte pour noël 1977 -, un truc dépressif dans un style minimaliste, genre Règlement de comptes à Mermoz.
Sous le soleil du 18 août 1989, alors que le sénateur Luis Carlos Galán s’était fait descendre par le cartel de Medellín, la tête d’Abdelaziz Bouzade avait percuté une bordure de trottoir à Bron, sur un parking près de l’autopont. Il n’y avait pas vraiment de lien, le légiste avait noté dans son rapport : fracture de la mâchoire, traumatisme crânien, commotion cérébrale, hémorragie. Je m’étais coltiné l’autopsie : les poumons étaient gris. Les amis de la victime prétendaient que des types du Mas du Taureau avaient débarqué pour une histoire de femme, qu’un grand basané avait défoncé leur pote. Les Arabes nous prenaient pour des branques. Ils nous toisaient du regard, une fois, deux fois. Quand le vieux les allumait à la régulière, ils faisaient moins les malins, baissaient les yeux avant la première gifle, couinaient comme des lopettes. Les bleus du quartier s’étaient pointés vingt-cinq minutes après l’agression. Abdelaziz Bouzade était mort d’un arrêt cardiaque dans un Renault Master du Samu. Il avait seize ans.
La pétasse avait eu comme un air de culpabilité la première fois qu’elle m’avait reçu dans son bureau. Nous, on s’en tapait que le quartier soit coupé en deux par une deux fois quatre voies. Ils avaient un supermarché, une pharmacie, une boulangerie, un tabac, un collège, une piscine, une MJC, on n’était pas payé pour comprendre. Pourtant, un paquet de connards nous reprochait qu’il y ait des lois depuis au moins Moïse. À Bron, à Vaulx, à Vénissieux, à la Duchère, c’était le même bordel. Ils s’amusaient à brûler des poubelles, des bagnoles, à pisser dans les cages d’escaliers, à défoncer les boîtes aux lettres, ils zonaient, balançaient des bouteilles en plastique remplies d’acide sur les vitrines, se la jouaient roi du wheeling sur des motos volées, ils squattaient les appartements vacants, caillassaient les camions de pompiers, dealaient, ils se tuaient entre eux.Les amis de la victime n’avaient pas reconnu le grand basané sur nos fichiers même s’ils n’avaient pas craché sur mes hommes lorsqu’ils s’étaient pointés dans leur quartier. J’avais envoyé Arnaud et Farid, ils avaient coopéré. L’homicide avait fait une manchette dans Le Progrès, des brèves sur FR3 et TF1. On faisait les titres depuis dix ans : Minguettes, Mas-du-Taureau, Hernu avait fait raser la cité Olivier-de-Serres en 1978 mais la situation avait empiré. Personne ne comprenait que c’étaient des cocottes-minute ces cités. Il restait des vieux dépassés ; les gosses qui trouvaient un job ou faisaient des études se barraient le plus vite possible et le plus loin possible des autres sauvages. La concentration de gris et de Turcs était incroyable, assaisonnée de portos, de nègres, de blancs devenus aussi gris que les autres. La soupape, c’était nous, les flics, vénérés chez l’oncle Sam et vomis ici par ceux dont on protégeait le plus le cul. Personne ne comprenait que la pression montait, que la soupape tournait jusqu’à s’en dévisser la tête et que le couvercle allait péter à la gueule du pays.
On tenait une piste grâce à des empreintes digitales retrouvées sur un panneau stop. On était toujours à la recherche de Tariq Nusayr, un Algérien de trente et un ans sous la menace d’une expulsion du territoire national. L’assassin d’Abdelaziz Bouzade, s’il était retrouvé, en prendrait pour vingt ans dont dix incompressibles. Puis il sortirait, et ça ferait un dealer de moins pour l’éternité et un autre pour une décennie. J’avais appelé la pétasse à 8 h 30 à son domicile pour l’informer de l’avancée du chantier. Elle avait décroché, dit :
- Inspecteur principal, vous vous foutez de ma gueule ?
J’avais laissé un blanc, rétorqué :
- Vous avez dit dès que possible.Les bons flics étaient de bons joueurs de cartes. Il fallait compter les délits, les couleurs, les morts, les atouts, être solidaire des partenaires, bien cerner les points forts des adversaires pour faire le dos rond en même temps que les points faibles pour appuyer quand ça faisait mal. Il fallait connaître le terrain et les règles indigènes, avoir du flair pour être chanceux, comme dans la vie.
Quatre papys s’agitaient à la table à droite de la nôtre, surtout le pied-noir à moustache avec le béret de marin en velours bordeaux et la Gitane maïs. Il annonçait ses tierces majeures comme s’il était encore propriétaire d’un domaine viticole dans l’Oranais, coupait en le disant pour l’expliquer alors qu’il se l’expliquait à lui-même. J’aurais bien envoyé le vieux lui mettre un coup de bocal quand il a coinché à cent trente carreau. Il aurait fait un mauvais flic, ne nous aimait pas. Mais c’était le cousin de Robert et Janine.
Les deux poivrots qu’on avait dégotés passaient leurs journées au bar. Ils avaient gagné la première, maîtrisaient les enchères, sentaient le moment où il fallait s’arrêter, menaient deux mille huit cent cinquante à deux mille cent trente. On s’accrochait. Le vieux a distribué, pompé sur son cigarillo. Il a regardé son jeu, j’ai examiné le mien. J’ai dit :
- C’est bon.
Le maigrichon en face de moi a tapoté sa Gauloise sur le cendrier qu’il partageait avec le vieux. Il a plissé les paupières.
- Pique. Quatre-vingts pique.
Luis - le vieux s’appelle Louis, mais on l’appelle Luis - s’est frotté le menton avec la main gauche. J’ai bloqué sur ses ongles trop longs et trop jaunes.
- C’est bon.
Le petit qui se tenait de travers sur sa chaise a inspecté son jeu, regardé son partenaire. Je l’ai étudié en latéral par-dessus mon valet de pique.
- Je mets dix à pique !
J’ai maté mon jeu, froncé les sourcils.
- Allez, cent trèfle.
Le maigrichon m’a fixé, il a eu un sourire en coin, le coin où ses lèvres pinçaient sa Gauloise.
- Je mets encore dix.
Luis s’est curé la molaire supérieure avec la langue puis avec l’ongle du pouce.
- On est à cent dix pique.
Il a collé un bout de côte de porc de la veille sur son pantalon en laine, fait comme s’il hésitait. Il a ajouté :
- Dix trèfle.
Le petit a toussoté. Il a rentré la lèvre inférieure dans sa bouche. Quand elle est ressortie, elle était aussi violette que sa langue.
- Pique !
J’ai pigé que son pote avait lancé avec la tierce majeure, un autre pique, et sans doute deux as en soutien, qu’à deux, ils avaient sept piques. J’ai temporisé, fait rouler un jeton de dix entre mon pouce et mon index, au moins vingt secondes. J’ai contemplé mon jeu. J’ai scruté leur tas de pions puis le vieux. Si je l’avais fixé plus longtemps, le petit se serait demandé si Luis ne m’avait pas adressé un message codé quand il a craché un nuage de fumée qui lui est remonté à moitié dans le nez. J’avais l’as de cœur, un carré de valet, j’ai dit :
- Deux cent cinquante à trèfle.
Le poing du petit a cogné la table, mon jaune a tremblé dans son ballon. Le petit a beuglé :
- Coinché !
Le vieux m’a fait un clin d’œil. Le petit était aussi fier que lorsqu’il nous a présenté la femme de son grand, c’était au mois de septembre. J’ai sorti une Pall-Mall, je l’ai allumée, j’ai bu une gorgée de Pastis.
- Surcoinché.
Le maigrelet a haussé les épaules, bouffé sa lèvre inférieure. Le petit est tombé de l’armoire quand j’ai lancé le sept de coeur en disant :
- Carré.
Le maigrelet a grogné :
- Tu t’es fait avoir comme un bleu, Jeannot. Qu’est-ce qui te prend de coincher ? On était dans la ligne droite, bordel.
Je leur ai refusé la belle, ils l’ont pris comme un affront. J’ai payé la démarrante. Je n’étais pas rentré chez moi depuis le jeudi. Un dimanche sur deux, à partir de 16h00, je fais le ménage. La vie, c’est rien d’autre que foutre le bordel et le ranger.
Quand je suis arrivé dans mon Alfasud banalisée à La Saulaie, en bordure de l’A7, j’étais plutôt satisfait des dernières heures de ma vie, même si j’ai toujours détesté le mois de novembre, trop loin de l’été, trop près de l’hiver. Ça venait des saveurs d’anis qui inondaient mon palais ou des 19°C ambiants, peut-être des deux. Une lettre des impôts attendait dans ma boîte aux lettres, la taxe d’habitation à régler, avec une enveloppe en papier kraft sur laquelle était inscrit mon nom, Michel Molina. Elle n’était pas affranchie. Il y avait deux coupures de presse. La première datait du 19 juillet 1969, la seconde du mercredi. Un touriste s’était noyé. Son corps avait été retrouvé dans le lac Léman.
19 juillet 1969 / Le Messager / « Rebondissements dans l’affaire du Château »(…) piste suivie par les enquêteurs jusqu’alors n’était pas la bonne (…) le portrait-robot diffusé dans la région ne correspond pas à (…) les services de police ont finalement arrêté hier l’assassin présumé de Ben Wallace, fils de Sir Thomas Wallace.
(…) d’un marginal, Jean Métral, qui a avoué l’avoir tué dans la soirée du 2 au 3 juillet. Les services de police ont retrouvé l’arme du crime dissimulée sous la caravane qui lui sert d’habitation (…) couteau de collection, d’origine japonaise (…)
(…) Jean Métral aurait été surpris par le jeune homme alors qu’il projetait de dérober des objets de valeur. Les services de police ont découvert à son « domicile » de nombreux objets volés. (…)
(…) a déjà été condamné à de petites peines de prison pour vol. Le vagabond pillait les villas d’Yvoire et du bord du lac, en particulier les résidences secondaires. (…)Des lettres découpées dans des magazines étaient collées sous le deuxième article, elles disaient : MOURIR DANS LES BRAS D’UNE FEMME, LIVRE DE FEU.
Je n’ai pas vraiment lu les articles. J’ai monté les deux étages de mon immeuble 1960. Je suis parvenu sur le palier, j’ai farfouillé dans la poche de mon blouson en cuir pour en sortir mon porte-clés tête-de-maure que j’ai ramené de Solenzara. J’ai ouvert, humé l’odeur de rance, contemplé la porte de la chambre au fond du couloir, un rectangle noir au fond d’un tunnel, le linge devant la porte de la salle de bains. J’ai appuyé sur l’interrupteur, les néons ont clignoté, comme si l’électricité avait du mal à sortir des fils, qu’elle était dans mon corps. J’ai posé les articles sur la table basse en pin du salon. J’ai fait le ménage.
Il n’y avait pas de vaisselle dans l’évier, pas de magazines au pied du canapé, juste des tas de linge dans le séjour, la cuisine, la chambre, le couloir. Un sous-verre fêlé avec un poster des Iris de Van Gogh traînait sur le grand mur du salon, un lit de poussière recouvrait la commode en pin, le meuble de télévision, les étagères à CD et à VHS. J’y ai passé l’aérosol de Pliz, un chiffon chamoisine déjà amoché. J’ai fourré le linge dans la machine à laver, rempli le réservoir de poudre Le Chat. J’ai sélectionné le programme numéro six, couleur quarante degrés. J’ai récupéré ma panière de linge propre dans la chambre d’amis, là où je dors les soirs de déveine pour salir les draps. Je suis monté au quatrième. J’ai frappé, Fatiha n’a pas répondu. Fatiha est ma voisine du dessus, elle touche les allocations familiales, repasse mon linge, cuisine épicée, mène ses deux gosses à l’école. J’ai posé la panière sur son paillasson. Je fais toujours comme ça quand elle est absente, la panière revient quarante-huit heures après.
J’ai vidé un demi-litre de vinaigre d’alcool dans la cuvette des toilettes, l’autre demi-litre dans le receveur de la douche. J’ai entrebâillé la fenêtre de la cuisine et celle de ma chambre pour faire courant d’air. J’ai passé l’aspirateur. J’ai fait chauffer un litre d’eau dans la bouilloire électrique, frotté le tartre dans les toilettes, dans la salle de bains. J’ai rincé la douche à l’eau froide, vidé l’eau bouillante dans les toilettes, gratté le tartre. J’ai tiré la chasse d’eau. J’ai pendu le linge sur le Tancarville orange, étendu le drap-housse entre deux chaises dans le salon.
J’ai lu les articles, le mot, MOURIR DANS LES BRAS D’UNE FEMME, LIVRE DE FEU. J’ai ouvert le frigo, ausculté chaque étage vide. J’ai attrapé la brique de lait dans la contre-porte. Elle a glissé, explosé sur le carrelage, des éclaboussures ont moucheté mon jean jusqu’aux genoux. J’ai claqué la porte du frigo, balancé un coup de pied dans la brique qui s’est écrasée contre le meuble de l’évier.
J’ai filé dans le salon, lu les articles, le mot : MOURIR DANS LES BRAS D’UNE FEMME, LIVRE DE FEU. Mon regard s’est perdu dans les empreintes blanches de mes semelles crantées. Elles menaient à la cuisine. J’ai épongé le lait avec un balai espagnol. Je ne l’essorais pas assez, les traînées de lait ont fini par mener à la table, aux articles, au mot.
J’ai quitté mes chaussures, me suis assis au bout du canapé, j’ai écouté le ronronnement du moteur sortir de derrière le frigo, les battements de la trotteuse taper contre la pendule, le souffle de la chaudière à gaz, les vibrations de la vitre du balcon, le sifflement éternel qui traverse les hommes seuls.
Je me suis allongé, j’ai fixé le plafonnier, chaque ampoule flamme, j’ai forcé, ça n’a rien fait passer, j’ai fermé les paupières. C’était là, ça avait toujours été là, c’était aujourd’hui, c’était sur ma table. Il fallait que ça passe.J’ai inséré The Joshua True dans le lecteur CD de ma chaîne Hi-Fi, mis le troisième single, With or without you. J’ai ouvert la porte du meuble bas sur lequel trônait ma Trinitron de vingt-sept pouces, saisi les télécommandes de la télévision et du magnétoscope Sony que j’avais achetés en début d’année chez But. Les articles de presse étaient toujours sur la table basse, avec la taxe d’habitation, le mot. J’ai appuyé sur Power puis sur Play, coupé le son.
Tracey Adams était assise sur un brun avec la nuque longue et une veste en jean, ses seins sortaient de son bustier, une brune lui léchait un mamelon, un autre gars filmait la scène. J’ai appuyé sur la touche FWD. Un nouveau type a débarqué, puis une autre nénette, c’était dans une grande maison. Tracey a fait un strip-tease, j’ai fixé sa montre-bracelet dorée, commencé à me branler. Le type a fixé une voilette noire sur sa tête, le film c’était La femme en noir. J’ai compressé la veine qui longeait la partie supérieure du cylindre hurlant, autoroute féerique des afflux sanguins, direct cœur-bite. La veine a gonflé.
C’était passé, ça n’avait jamais existé.
Quand elle s’est mise à quatre pattes sur le fauteuil, le type a inséré son membre dans son vagin, par-derrière, elle a planté ses ongles vernis rouges dans sa fesse gauche. J’ai éjaculé. C’était In God’s country qui sortait des baffles. J’ai observé les articles sur la table, la feuille des impôts. Je ne baisais que des putes et ma main droite. Ça faisait vingt ans.
- François Médéline au salon du livre d'expression populaire et de critique sociale d'Arras Le 1er mai 2024
Retrouvez François Médéline lors de la 23e édition du salon du livre d’expression populaire et de critique sociale, organisé par l’association Colères du présent à Arras le 1er mai.
- François Médéline à Lille Le 2 mai 2024
François Médéline sera en rencontre à la librairie Les Quatre chemins de Lille, en partenariat avec l’association Autour des livres, le 2 mai prochain.
- François Médéline à la librairie 47° Nord Le 3 mai 2024
Venez à la rencontre de François Médéline et de La Résistance des matériaux le 3 mai à la librairie 47° Nord de Mulhouse !
- François Médéline dans les Vosges Le 4 mai 2024
Retrouvez François Médéline dans les Vosges le 4 mai prochain :
- À la librairie Le Neuf de Saint-Dié-des-Vosges de 10h30 à 11h30
- À la librairie Quai des mots d’Épinal de 18h30 à 19h30
- Nos auteurs au salon Vins noirs de Limoges Le 24 mai 2024
François Médéline et Lionel Destremau seront présents lors du salon Vins noirs de Limoges entre les 24 et 25 mai, venez à leur rencontre !
- Nos auteurs à la 9e édition du festival Lisle Noir Le 21 septembre 2024
Retrouvez Lionel Destremau, François Médéline, Benoît Séverac et Ian Manook au festival Lisle Noir, à Lisle-sur-Tarn, les 21 et 22 septembre.
Actualités- Blanches et La Résistance des matériaux présélectionnés au prix "Coup de cœur de la 25e Heure"
Quelle joie de vous annoncer la présélection de deux romans de notre rentrée 2024, Blanches, de Claire Vesin et La Résistance des matériaux, de François Médéline, au prix "Coup de cœur de la 25e Heure" de l’association La 25e heure du livre !
Documents à téléchargerDocuments à télécharger
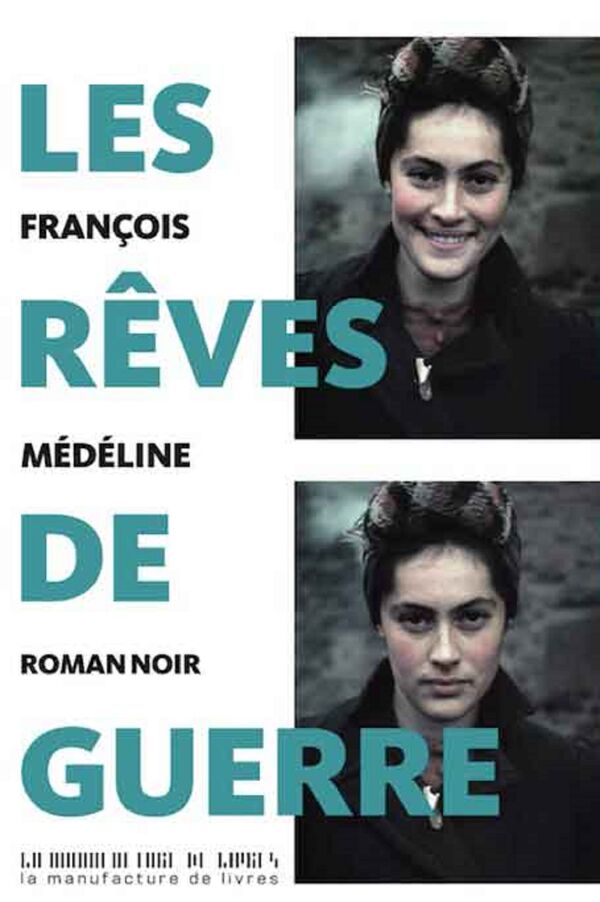
Crédits
© 2024 la manufacture de livres. Tous droits réservés.
Le site est entièrement réalisé à la main par Cédric Scandella
Les textes sont tous écrits par l'équipe de la Manufacture de Livres
Mentions légales
https://www.lamanufacturedelivres.com/
SL Publications
Représentant légal et directeur de la publication : Pierre Fourniaud
101 rue de Sèvres
75006 Paris
33 1 45 66 90 08
Siren : 505 303 065 RCS paris
Siret : 505 303 065 000 13
VAT FR94505303065
SARL au capital de 10 000 euros créée le 8 juillet 2008
Droits d’auteur et de propriété intellectuelle
Tous les contenus de ce site Internet textes, photographies, illustrations, etc. sont protégés par les lois françaises et internationales du droit d’auteur. Toute reproduction de ces contenus est interdite hors utilisation promotionnelle et médiatique des visuels de couvertures, photos d’auteur et visuels des éléments promotionnels à télécharger (mention du copyright obligatoire).
Hébergeur du site
Scaleway
Liens hypertextes
La Manufacture de livres décline toute responsabilité quant au contenu des informations ou services fournis sur les sites activés par les liens hypertextes et quant aux difficultés que l’internaute pourrait rencontrer pour y accéder.
Loi Informatique et Libertés
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à La Manufacture de livres. L’éditeur s’engage à ne pas transmettre à des tiers les données personnelles que vous lui communiquez via le site Internet, qui seront utilisées uniquement afin de communiquer avec vous suite à votre demande.
Google Analytics
Ce site n’utilise pas Google Analytics. Point barre.
Données personnelles
Nos engagements
Vos données sont utilisées uniquement pour des finalités explicites, légitimes et déterminées en lien avec notre activité,
Seules les données qui nous sont utiles sont collectées.
Nous ne conservons pas vos données au-delà de la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées, ou de celles prévues par les normes et autorisations de la CNIL ou par la loi (prescriptions légales).
La Manufacture de livres s’engage par ailleurs à respecter et défendre la charte régionale des valeurs de la République et de la Laïcité.
Utilisation de vos données
Les informations et données personnelles sont recueillies de manière sécurisée et cryptée pour les finalités suivantes :
- envoi de newsletter
- échange dans le cadre de la relation commerciale
Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée réglementaire :
- Prospection : 3 ans à compter de leur collecte.
- Gestion commerciale/fichier client : Le temps nécessaire pour la gestion commerciale.
- Gestion de prospection/fichier client : 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale.
Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée par une disposition légale ou réglementaire. Vous pouvez exercer, dans les conditions prévues ci-après, lun des droits qui vous sont reconnus par la législation.
Vos droits
Droit daccès et de rectification
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit :
- d’accès,
- de rectification,
- de portabilité et d’effacement des données ou encore de limitation du traitement.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Pour mieux connaître vos droits, rendez-vous sur le site de la CNIL : www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant La Manufacture de livres - 101 rue de Sèvres - 75006 Paris
Le responsable de traitement des informations personnelles est lamanufacturedelivres.com contact@lamanufacturedelivres.com
Vous êtes encore là ? - François Médéline à Lille Le 2 mai 2024