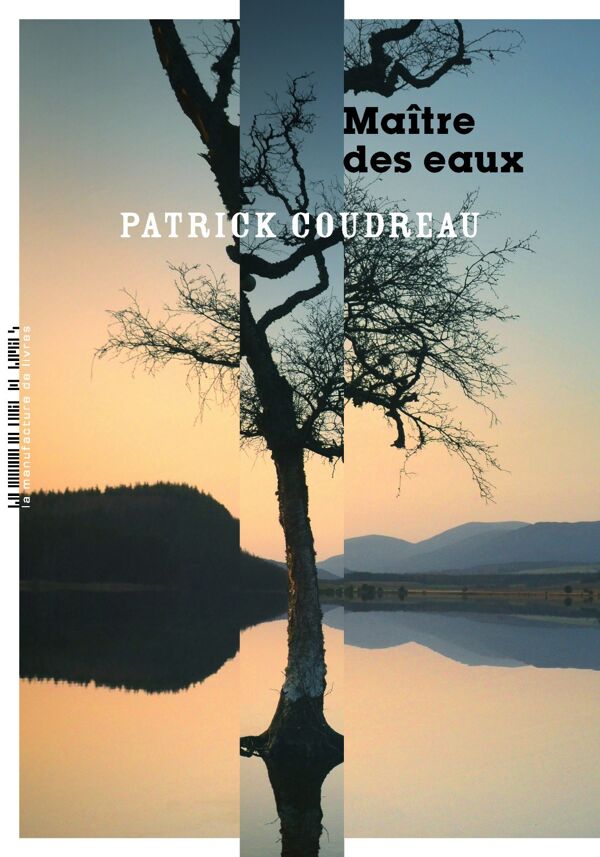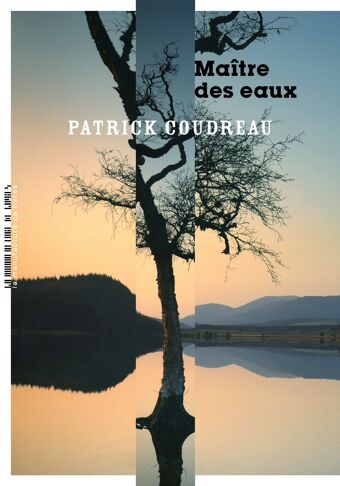
Patrick Coudreau
Maître des eaux
Au village, on disait de cette famille qu’elle était étrange, que l’eau lui obéissait et que les catastrophes arrivaient par elle. Et puis, il y eut l’incendie et tout rentra dans l’ordre. Aujourd’hui, le fils est revenu avec l’envie de régler ses comptes. Il a amené avec lui la pluie qui ravage tout, car lui aussi, dit-on, sait converser avec l’eau. Maintenant il se cache au cœur de la nature, quelque part près du village, voulant se faire oublier, et une gamine a décidé de lui venir en aide. Mais pour les hommes du village, la traque est ouverte et ne s’arrêtera que quand cette affaire sera définitivement réglée…
Avec ce premier roman qui se lit d’une traite, Patrick Coudreau nous invite dans un univers littéraire plein de suspense, de poésie et de magie.
- Revue de presseUn premier roman très réussi.On plonge dans l’univers clos d’un village avec ses secrets et ses mythes.Sensible aux enjeux écologiques, l’auteur entraîne le lecteur dans un récit haletant où la pureté de la nature s’oppose à la noirceur de l’âme humaine.
- Avec un style fluide et réaliste, l’auteur nous plonge dans un roman où poésie, magie et réflexion sur la société cohabitent. Sublime !On se plonge avec beaucoup de plaisir dans ce premier roman plein de suspense dressant le portrait d’un héros meurtri qui trouvera refuge dans une nature imprévisible et auprès d’une jeune fille pleine de courage. Un roman noir captivant et très bien écrit !Du suspense, de la magie, la nature face à l’homme. À découvrir !Un livre que je n’ai pas lâché. J’ai beaucoup aimé les descriptions de la nature, la profondeur des personnages, le rythme de l’histoire.Génial ! Une très belle histoire de vengeance.Un gros coup de cœur !
- téléchargez l’extrait
Mathias Grewicz enrage. L’inondation a tué des bêtes, détruit des cabanons dans les jardins en contrebas du village, endommagé une poignée de maisons, mais pas un seul habitant n’y a laissé la peau. Ce n’est pas ce qu’il a demandé au ciel lorsqu’il lui a parlé l’autre soir. Non, il lui a dit : « Raye Brissole de la carte et tous les salopards qui y vivent bien au chaud. Épargne seulement ceux qui ne sont pour rien dans ce qui s’est passé. » Il était certain d’avoir été entendu puisqu’à ce moment-là le vent s’est levé et a soufflé de plus en plus fort. Sa manière à lui d’acquiescer. Mathias le connaît, depuis le temps. Pendant des années, il a partagé ses humeurs, ses colères, ses jeux de gosse. C’était lorsqu’il allait de ville en ville à travers le pays, empruntant des chemins sinueux, s’enfonçant dans des bois touffus, comme une bête qui essaie d’échapper aux chasseurs. Et aujourd’hui, ils sont là. Il les voit s’approcher, leurs silhouettes grandir, portées par des cris de haine : « Gréviche, on va te faire la peau ! » ; « Tu peux te planquer, on finira bien par te mettre la main dessus ! » Des rires fusent, puis les menaces reprennent : « Nom de Dieu de Gréviche ! C’est à cause de toi, on le sait, que toute cette eau a ravagé le village cette nuit ! T’as intérêt à bien te cacher, parce qu’on va pas te louper, sale bête ! » Démon, barbaque, ou encore rat crevé : voilà les insultes auxquelles Mathias a eu droit dès le lendemain de son arrivée à Brissole, sans parler de son nom à qui on a tordu le cou pour en faire Gréviche, ou bien encore Grévisse, lequel a glissé vers Écrevisse.
Quoi ! Mathias Grewicz osait remettre les pieds à Brissole ? Qu’est-ce qu’il voulait ? Prendre la succession de son salopard de père peut-être ? Élever des chèvres, des vaches d’une race remise au goût du jour, des chevaux peut-être, ou bien encore des bisons, allez savoir avec un revenant de ce genre ! En inventant au passage une méthode moderne – autant dire déloyale – pour concurrencer ceux qui travaillent de manière honnête. Fallait croire qu’il n’avait pas compris la leçon qu’on avait donnée à sa famille. C’avait été une belle raclée, pourtant ! On pouvait pas plus belle, enfin, façon de parler, mais ils l’avaient bien cherchée, ces malfaisants. Ce qu’ils avaient fait, c’était pas pardonnable, c’était même pas possible de l’envisager une seconde, fallait vraiment être un Grewicz pour ça. Une sale race, une engeance maudite, ni plus ni moins. Il y avait combien de temps de ça, au juste ? Quinze ans, peut-être plus, vingt. Oui, c’est ça, les mémoires se sont remises en marche, vingt ans et une poignée de mois ; on est en avril, le mois idéal pour reprendre les choses en main, sceller les sorts.
Il s’en était tiré, mais cette fois, on ne va pas le rater, le fils Grewicz. Il a pas dû comprendre à l’époque – quel âge il avait ? Onze, douze ans – qu’à Brissole, il n’y avait pas de place pour les gens d’ailleurs, les étrangers et tous ceux qui leur ressemblent, immigrés et compagnie. On a déjà suffisamment de mal à faire manger les gens d’ici. À vivre de sa terre, de ses bêtes, sans qu’on soit enquiquinés par d’autres, qui ont des façons de faire par en dessous, qui se paient le luxe d’avoir du matériel qu’ils vont chercher le diable sait où, et avec quel argent. On l’a vu renifler du côté où il vivait avec ses parents, et le vieux, l’ancêtre, qui rôdait toujours où il ne fallait pas, l’oreille traînante et bonne rapporteuse. Parole, il veut remettre ça, y a pas de doute.
On va lui faire payer son audace, lui faire ravaler ses projets, au Gréviche-Écrevisse, au Gréviche tourneur, là. Avec ses pouvoirs maléfiques (c’est Marie Talente qui voit tout qui a tout de suite tiré la sonnette d’alarme quand elle les a vus arriver, les Grewicz, elle s’y connaît en tordus et faux voyants de toutes les couleurs), il a cru pouvoir faire disparaître Brissole sous les eaux, mais le ciel, le vrai, celui où officie le bon Dieu, pas le diable comme celui que fréquente Grévisse, ne l’a pas entendu de cette oreille. Ça a dû s’empoigner, là-haut, pour décider des choses. Les dégâts, on va s’en remettre, et en un tour de main encore, mais lui, le Mathias, il ne s’en relèvera pas. Au pas, qu’on va le mettre. Mais bien plus que ça : on va en finir une fois pour toutes avec cette famille d’orties et d’épineux ou ce qu’il en reste, c’est-à-dire lui, Écrevisse. Comment on va le truffer de plomb, le saigner à blanc et jeter sa carcasse aux charognards ! Et y aura pas grand monde à s’en plaindre, sauf, peut-être, les deux walkyries à qui il a déjà réussi à écarter les cuisses, ce jeanfoutre (elles ne perdent rien pour attendre, les garces, un jour la vengeance leur tombera dessus à elles aussi). Avec sa balafre qui lui court sur la tempe droite, il a pourtant de quoi faire peur plutôt qu’autre chose. Mais y a des bonnes femmes que ça arrête pas, au contraire. Mais c’est fini, tout ça. Ça n’aura pas duré longtemps, deux petits mois à peine. Pendant lesquels on lui a pas fait de cadeaux. À commencer par les gamins qui, en bons petits patriotes citoyens à qui on a tout de suite expliqué la situation, lui ont balancé des pierres. Il s’en est pris une sur la pommette droite, une fois. Juste sous la balafre. Ce qui lui en a dessiné une deuxième. Parce que vous pensez bien qu’on allait pas le soigner. Il a dû se démerder tout seul. Faut voir le résultat !
Les gendarmes ? Ils n’ont rien vu, rien dit. Ils ont vite compris, lorsque la brigade a été renouvelée il y a trois ans, qu’ici, mieux vaut ne pas trop se mêler des affaires auxquelles on ne comprend pas grand-chose, qui remontent à loin parfois, enfouies sous la terre et la caillasse, et qui ressortent un beau matin pas beau, comme ça, sans même que la pluie ait remué le terrain. Ce Grewicz, là, un curieux type, un vagabond, qui a grandi ici à ce qu’on leur a dit, et disparu après une sale histoire à dormir debout, il est plus prudent de s’en tenir à distance, de ne pas l’avoir remarqué déambulant avec des regards à droite à gauche et des airs de ne pas être sûr de lui – ou trop sûr peut-être. De là à lui mettre sur le dos l’inondation qui a secoué la commune l’autre nuit, c’est un peu fort. Pour preuve, personne n’a porté plainte contre ce revenant, c’est tout dire. « On ne fait rien, mon capitaine ? » a interrogé le brigadier Desrozes. « Rien. On ne bouge pas », a ordonné le maréchal des logis chef Plaimpied.
« On arrive, Barbaque ! Prépare-toi à en baver ! » ; « On va te recoudre la gueule à notre manière, tu vas voir ! » ; « Tu le regretteras pas ! » Rires, poings levés. Des mains brandissent des carabines, d’autres un bâton, d’autres encore une pioche ou une fourche. « On est au Moyen Âge, halète Mathias, une vraie jacquerie ma parole. Si ces salopards me rattrapent, ils vont me dépecer comme un porc. » Le sac sur son dos lui pèse mais impossible de s’en défaire : il contient le peu qu’il possède. Il en veut au ciel qui ne lui a pas accordé la faveur qu’il lui demandait, il en veut à la Tournèze, la rivière qui traverse le village, qui n’a fait son travail qu’à moitié, à croire qu’elle est du côté de ces chacals. Du temps où il y jouait pourtant, elle lui souriait, l’aimait bien, une complicité s’était nouée entre eux. Elle ne lui a sans doute pas pardonné d’être parti, de l’avoir abandonnée. Il n’avait pourtant pas le choix, il s’en serait passé, de partir comme un voleur, sauf qu’un voleur ça ne s’enfuit pas les larmes aux yeux et en criant, avec de sales images dans la tête. Lorsqu’il est allé la voir en arrivant (sa première visite a été pour elle), elle a fait celle qui ne le reconnaissait pas. « C’est moi, Mathias Grewicz. Je suis de retour. Ne me dis que tu ne te souviens pas de moi… » L’eau se souvenait, bien sûr, mais elle n’a pas bronché, elle a continué son chemin entre les algues filamenteuses, les lentilles d’eau et les élodées. Il pouvait lui raconter ce qu’il voulait, ce grand costaud qu’il était devenu, il pouvait lui faire les yeux doux – ces yeux de couleur différente, l’un très bleu, l’autre gris-vert –, il perdait son temps. Même la nature se bouchait les yeux et les oreilles, se retournait contre lui s’il comprenait bien.
S’il parvient à gagner le bois des Milaudes, frais et profond, et mieux encore, à atteindre les ruines du château du même nom, capables encore d’abriter quelqu’un, il est sauvé. Mathias rassemble ses forces, tire sur ses muscles, ses jambes rétives (il est loin le temps où il était capable de boucler trente à quarante kilomètres dans une journée, ces derniers mois déjà il faiblissait). Les sapins se rapprochent, à ses trousses les autres semblent perdre du terrain, il reprend confiance. Soudain, un coup de feu dont l’écho n’en finit pas : Mathias chancelle en grimaçant ; le plomb a traversé le bras droit, en plein biceps. Derrière lui, des cris de victoire : « On l’a eu ! On l’a eu ! Il est cuit ! » Surtout, ne pas s’arrêter, oublier la douleur, la faire taire, ne pas prêter attention au sang qui macule les carreaux de la chemise. Continuer. Aller plus vite. À travers les hautes herbes le sentier grimpe, têtu. Mathias s’y accroche, lui demande de l’aider. « Donne-moi la force. Fais que ces mecs, là, derrière, perdent pied. Lance-leur des pierres, provoque des éboulis je t’en conjure. »
Pas d’éboulements, de glissements de terre mélangée à la caillasse, mais tout à coup, de bleu parsemé de nuages blancs, le ciel vire au sombre et commence à larguer en salves drues une pluie oblique, serrée, lourde, qui très vite gomme le paysage, efface la distance entre les chasseurs et leur proie.
Voilà les pins, les sapins, les chênes verts, quelques genévriers qui oscillent sous la pluie rendue plus ardente encore par le vent qui a sonné la charge. Mathias slalome entre les troncs dont l’écorce brille, les haies de fougères s’écartent sur son passage, des branches tombées sur le sol détrempé se relèvent afin de ne pas gêner la progression de celui qui les frôle, le souffle saccadé, moitié titubant moitié grommelant. Un aboiement soudain. Les chasseurs n’ont pas renoncé, ou du moins ils ont libéré leurs chiens qui, dans un premier temps, vont faire le travail à leur place. Mathias avise un amas de branchages au pied d’une grappe de sapins aux troncs collés les uns aux autres, pris d’assaut par la mousse et une colonie de champignons. Une sorte de hutte bâtie par la nature elle-même, coup de vent après coup de vent, patinée par les pluies. Il s’y glisse, le visage dégoulinant de sueur, mèches plaquées sur le front, se laisse tomber sur le sol que jonchent des pommes de pin, des herbes et des fougères qui pourrissent. La brûlure le brûle. Il est épuisé. Il faut qu’il dorme. Pourvu que ces sauvages fassent demi-tour, découragés par la pluie, sachant que ce n’est que partie remise. Au moins pourra-t-il gagner du temps.
Il tend l’oreille. Il semble que les chasseurs aient renoncé. Soudain un chien se pointe. Un épagneul français. La truffe luisante s’immisce entre les branchages noircis par l’humidité. Le regard pénètre celui de l’homme caché là-dessous. Mathias tente le tout pour le tout.
« Je te reconnais, tu es une bonne bête, n’aboie pas, surtout n’aboie pas, je t’en prie, retourne d’où tu viens… »
L’animal lâche un bref gémissement et recule.
« C’est ça, ma bête, c’est bien. Va, et ne dis rien à ton maître. »
Un autre aboiement, un peu plus loin sur la gauche. Mathias frémit. Il est parvenu à amadouer l’épagneul, mais la chance risque de ne pas lui sourire une deuxième fois. Le découragement, la douleur l’accablent, lui arrachent des larmes. Il ferme les yeux, les poings, attend l’ennemi. Il rouvre les yeux, le paysage est flou.
L’autre chien a levé un lièvre, ou un tétras. L’épagneul le rejoint, ventre à terre, en aboyant tout ce qu’il peut. Mathias redoute l’arrivée de ses poursuivants, lesquels, contrairement à ce qu’il pensait, n’ont pas rebroussé chemin. Les jappements s’éloignent, la pluie redouble. Mathias perçoit des voix, des appels à faire demi-tour. Enfin ! « Saleté de temps !.. On reviendra, Barbaque. Le ciel est de ton côté mais le soleil revient toujours après la pluie, tu sais ça comme nous hein, et alors, on te débusquera comme le rat que tu es, quitte à mettre le feu à la forêt, t’entends ?... Reprends des forces en attendant. Et cherche pas à te barrer de ton piège, on a vu du sang figure-toi, avec ce que t’as dû prendre dans le coffre, t’iras pas loin ! »
Ils peuvent aboyer pire que leurs chiens, ricaner et vociférer pire qu’une meute de palefreniers ou de marchands de bestiaux, Mathias ne les entend plus. Au-dessus du faîtage de la hutte, le ciel a chaviré.
2
À présent la pluie a cessé, le ciel s’est entrouvert pour laisser place au soleil. De quoi sécher les troncs, les feuillages, les fougères au pied desquels Mathias, qui a sombré dans un sommeil agité, se réveille peu à peu, écarquillant les yeux. La blessure à son bras le relance aussitôt. Sous la chemise déchirée, la plaie est profonde, et suffisamment large pour apercevoir le plomb qu’un de ces lâches a logé dans le gras du muscle. Pas le choix : il faut l’extraire, puis faire un pansement qui vaudra ce qu’il vaudra. Mathias extirpe de son sac son couteau et le briquet qui, même s’il n’a jamais fumé, ne le quitte pas. Il fait partie de son matériel de survie. Il saisit la fiasque d’alcool de prune et en boit une rasade, passe la lame dans la petite flamme jaune et bleue puis la glisse dans la plaie où le sang a bruni. En grimaçant, il la fait aller, creuse – « attrape ce fichu plomb, déloge-le de là » – et lorsque l’acier rencontre l’intrus, Mathias ne peut retenir un gémissement. Mais pas de question de flancher maintenant. Nouvelle rasade, plus longue cette fois. La sueur perle à son front, s’évacue dans son cou. Le couteau fait son travail, c’est un bon élève, il connaît bien sa leçon, il a déjà eu l’occasion de le prouver.
C’était il y a longtemps, Mathias s’était blessé à la cuisse droite avec du fil barbelé, un bout de ferraille rouillé avait lacéré la chair sur plusieurs centimètres avant de se casser et de s’infiltrer dans la déchirure. Mathias avait dû reprendre sa marche en s’aidant d’une branche pour béquille. Un pharmacien compréhensif l’avait soigné. Aujourd’hui, pas d’âme charitable, il imagine la tête des deux pharmaciens de Brissole s’il débarquait chez eux ! Le docteur Blet le soignerait, lui, son père avait toujours éprouvé de l’estime pour la famille Grewicz, débarqués de loin, alors pourquoi pas le fils, mais Mathias ne se voit pas redescendre au village, même à la nuit tombée, cette fois la meute ne le louperait pas.
Il lui faut se débrouiller seul, heureusement la lame est têtue. Elle a repéré le plomb et la voilà qui, d’un coup, l’extirpe de la chair et l’expédie contre un tronc sur lequel il rebondit avant de se perdre parmi les fougères. Cette fois, l’alcool de prune n’est pas pour le gosier mais pour la plaie. Cela brûle plus sûrement que tout autre désinfectant. Mathias porte cette fois le goulot à ses lèvres avant d’improviser un bandage avec un mouchoir. Il grimace, mais la tête lui tourne moins que tout à l’heure, et le soleil lui réchauffe les os, commence à sécher ses vêtements. Cela devrait aller mieux.
De quoi pouvoir quitter cet abri incertain en prévision d’une nouvelle traque. Il n’est que trois heures de l’après-midi, Mathias sait qu’une fois la digestion achevée et l’estomac rempli, les chasseurs vont remonter à l’assaut. Brouiller les pistes, voilà ce qu’il faut faire. Conduire les soudards vers les ruines du château, laisser quelques traces de sang sur les pierres et la terre qui redevient sèche, accrocher à un épineux quelques centimètres carrés de tissu arrachés à son ourlet de pantalon, fouler l’herbe alentour, et disparaître, se poster plus loin, sur les hauteurs, pour observer leur manège et la stratégie adoptée. Ce qu’il craint surtout, ce sont les chiens, dont certains, il a pu en juger en arrivant, sont des molosses prêts à tout dès lors qu’ils sont aiguillonnés par leurs maîtres. À une époque, il savait les amadouer tous, sans exception, du roquet le plus teigneux au dogue le plus impressionnant, mais, il ignore pourquoi, en la matière il a perdu son savoir-faire, son pouvoir. Il n’a toutefois pas dit son dernier mot, il ne s’avoue pas vaincu. Il a remarqué que, parfois, dans le feu de l’action, sous le coup d’une émotion ou d’une urgence, le don lui revenait.
Tandis qu’il se hâte vers les hauteurs de la motte féodale, il se rappelle ce que lui avait enseigné son grand-père, Ladislas Grewicz, pendant que ses parents s’occupaient des bêtes. Il n’avait pas son pareil pour communiquer avec la nature. Ainsi, au début de leur installation au lieu-dit « Les Haies », à la lisière du village, il avait fallu dompter le petit ruisseau qui, à un moment, dessinait un bras à la Tournèze, afin que le troupeau puisse boire l’eau on ne peut plus naturelle qui dégringolait d’une des trois collines qu’on avait baptisées « collines des cornes » à cause de leur forme pyramidale et effilée à leur sommet tel un attribut de bovin. Ce fichu ru ne voulait rien savoir, il continuait sur sa lancée à travers champs, tel un gamin buté, colérique, qui s’obstine à dire non à tout. Les travaux n’ayant rien donné – que le maire, du reste, ne voyait pas d’un bon œil, au nom de quoi les Grewicz se permettaient-ils de vouloir détourner le Tercelet, l’idée n’avait jamais traversé l’esprit d’aucun Brissolien –, grand-père Ladislas s’était rendu un soir, à la nuit tombante, au bord du cours d’eau. Mathias l’avait suivi discrètement, et même si le vieil homme s’était aperçu de sa présence, il ne lui avait pas demandé de rebrousser chemin.
Ne jamais couper le fil, laisser s’épanouir et durer les secrets.
Et ce que le petit Mathias avait vu alors, il ne l’oublierait pas de sitôt. Ladislas Grewicz s’était accroupi et avait commencé à parler au ruisseau. Ses mots chuintaient comme l’eau, des mots magiques dans une langue étrange que l’enfant avait du mal à comprendre, ils composaient une sorte de chant, une incantation, et pendant que les paroles caracolaient, tels des cailloux portés par le courant, l’homme maintenait ses mains au-dessus du Tercelet. À un moment, Mathias n’avait plus entendu l’eau tracer sa route ; s’approchant, il avait remarqué que peu à peu elle cessait de couler, n’apparaissant plus dans le sillon qui constituait son lit que par endroits, sous forme de flaques et de brefs rejets intermittents qui rappelaient ceux d’un geyser. Le ruisseau avait été empêché d’aller de l’avant, étranglé, ligaturé. Le vieil homme avait alors usé à nouveau de mots secrets mêlés à des onomatopées ; il avait encore égrené quelques paroles en forme de prière puisées, cette fois Mathias les avait reconnus, dans le Talmud et, deux minutes plus tard, il baissait les bras et s’écartait pour laisser passer l’eau qui, détournée de son cours naturel, avait creusé un nouveau chemin à travers les pâturages, en direction de l’exploitation. Devant l’air abasourdi de son petit-fils, Ladislas Grewicz avait ri.
« Retiens ce que tu as vu et entendu, cela t’aiderait dans les situations difficiles. Tu n’as pas compris tous les mots, mais je te les expliquerai, et je t’enseignerai d’autres choses. »
Tous deux avaient regagné la maison déjà endormie.
Quelques jours plus tard, le vieil homme entreprenait de confier à Mathias quelques-uns de ses « secrets » pour défier les dangers, apprivoiser la nature, « pas la mort, c’est impossible, mais au moins essayer de faire en sorte que la vie gagne le plus souvent possible.» Au moment de quitter les siens, il lui avait remis un carnet de cuir brun, élimé, contenant des « règles », avait-il dit, des formules et des gestes à assimiler. « Ton père n’a jamais su les apprendre et les mettre en pratique, c’est bien dommage », avait-il soufflé entre deux grimaces provoquées par la douleur,
Mathias n’avait pas réussi à reproduire avec la Tournèze ce que son grand-père avait fait avec le Tercelet. À la vue des lieux où s’était produit le drame, sous le coup de la douleur ses savoirs lui avaient peut-être fait faux bond, ou peut-être l’avaient-ils servi de travers. Mais il recommencerait, et cette fois il réussirait.
Pour le moment, il lui faut prendre de l’avance sur la horde menée par Préret, le maire au ventre en forme d’outre (Mathias a reconnu sa voix, régulièrement, pendant toutes ces années, elle a remonté le temps comme un corps refait surface pour lui marteler les tempes), Bernoux, l’ancien menuisier, Lanquère, dit Fivaire, diminutif de Ferroviaire, un cheminot à la retraite (lui aussi a eu droit à un sobriquet, comme Écrevisse, mais attention, pas de comparaison possible, en ce qui le concerne c’est une manière de lui taper sur l’épaule, il est du cru, lui, il ne vient pas d’ailleurs, il n’est pas un errant, un « migrant »). Se sont joints à eux trois bons à rien toujours prêts à faire feu sur la première bête aux abois, et sur quelqu’un si nécessaire, regardez Grévisse ! Si c’est pas une bête aux abois, qu’est-ce que c’est ?! Il y a là Belmond qui tient l’armurerie du bourg, un amoureux des armes, un vrai de vrai, qui doit dormir avec une carabine ou un revolver dans ses draps à défaut d’avoir pu y glisser une femme ; à chaque mot qu’il prononce, Fivaire approuve d’un hochement imbécile de la tête, en admirant son mentor, comme s’il avait fait le tour du monde à dos d’âne. Vient ensuite Soulange, le boucher, qui n’a jamais pu supporter les Grewicz, qu’il découperait volontiers n’avait-il pas hésité à affirmer un jour, puis Lotrain, un violent, moitié ouvrier agricole moitié baratineur, qui ne vivait pas à Brissole à l’époque où les choses se sont passées mais à qui cette chasse à l’homme aiguise les sens. Un peloton, une bande de crânes vides, percés, d’idiots atteints de méchanceté aiguë, à l’esprit de vengeance ou de revanche, capables de partir à l’attaque sans savoir pourquoi.
Lorsqu’ils avaient croisé le premier jour de son retour un Mathias raide comme un poteau et au pas trop tranquille, sacrément costaud il faut bien le dire, avec un sourire en coin et un regard pareil à un dard, Préret, Fivaire, Bernoux et Belmond sortaient du café Petitclerc l’allure hésitante – avaient dû trinquer à plusieurs reprises à la santé de l’ennui, le second avait peut-être fait affaire, vendu quelque arme à vil prix à un amateur de passage ou à un professionnel roulé dans la farine. Mathias s’était gaussé devant leur expression de visage, mélange de stupéfaction et d’hébétude, les uns saisissant les bras des autres comme pour s’assurer qu’ils n’avaient pas fait un cauchemar, que c’était bien le fils Grewicz et personne d’autre qui se repointait, et pas peu fier encore, ne cherchant pas même à se faire tout petit. Ils avaient tout de suite reconnu les yeux vairs, ce sourire qui vous aiguillonne, il chialait comme un agneau égaré lorsqu’il avait décanillé cette nuit-là, mais cette fois, il avait rangé son mouchoir, il ne chialait plus il souriait, il riait même, un comble. Bon sang, ça ne sentait pas bon, il était urgent de prévenir les autres.
Le sentier monte rude jusqu’aux ruines. Au pied du donjon épargné pour moitié par les ravages des siècles, mais dont le pan droit est fissuré de haut en bas, Mathias reprend son souffle, réajuste son bandage. La douleur est moins forte. Avec son couteau, il découpe un bout de pansement bruni par le sang, l’accroche à un épineux, bien en vue, s’il n’y a pas de vent il sera toujours là lorsque la horde reviendra. Plus loin, à hauteur de ce qu’il reste de la poterne, entre deux pierres blondes d’où s’ensauve une couleuvre il laisse tomber trois centimètres carrés d’ourlet de son pantalon qu’il a préalablement froissés, déchirés. Puis, sur une pierre aussi ronde qu’un galet, parmi un récent éboulis, Mathias abandonne un peu de sang qui, en tombant, prend la forme d’une étoile dont les branches s’épanouissent. Un jeu de piste pour les chasseurs qui ne manqueront pas de triompher en désignant les traces, qui iront renifler plus loin mais finiront par tourner en rond, s’enliseront comme dans des sables mouvants – ce serait si bon de voir les uns après les autres avalés par les éléments ! –, Mathias va leur faire faire un petit tour des ruines une fois, deux fois, trois fois, jusqu’à ce qu’ils aient le tournis, que les uns finissent par se retrouver nez à nez avec les autres en finissant, excédés, par se traiter de tous les noms. Et de là-haut où il se postera, il les verra repartir bredouilles en pestant, en bougonnant, Bernoux le fusil en l’air comme pour célébrer la victoire qu’il n’a pas décrochée, Fivaire arrimé à lui, regardant ses bottes griffées par les ronces, une paire qu’il chausse pour les grandes occasions comme on enfile son costume du dimanche, abimée pour rien, pour un youpin qu’on n’a pas pu dénicher.
Mathias hisse son paquetage sur son dos, mouvement qui déplaît à sa blessure, et gagne la crête dite de Triste-Dieu brûlée par le soleil revenu en force, et qu’on atteint après avoir traversé le bois des Ebrèges. Plus étendu et plus touffu que celui des Milaudes, Mathias se souvient en riant dans sa barbe qu’à l’époque les Brissoliens n’aimaient guère s’y aventurer (de mauvaises ombres hanteraient, à la tombée de la nuit, les mares stagnantes et, plus haut, les deux cascades dont les eaux dégringolent, une sacrée descente, jusqu’à la Tournèze) ; les choses n’ont guère dû changer, à Brissole le temps ne change rien aux croyances.
C’est là qu’il décide de s’arrêter, au pied d’un rocher au sommet duquel il pourra se hisser en cas de besoin et qui, surtout, le dissimule, lui assure une protection, une armure surdimensionnée. Un observatoire parfait pour observer le manège de Préret et son armée de pacotille.
Emporté par la fatigue, les élancements à son bras, chauffé par le soleil et tenaillé par la faim et la soif, il s’est assoupi sans s’en rendre compte et il se réveille d’un coup, oppressé. S’ils l’avaient surpris, s’ils étaient là autour de lui, cachés dans les fougères et derrière les sapins et les chênes, attendant de lui tomber dessus dès qu’il ouvrirait les yeux ? Il se redresse, s’abrite derrière le rocher, scrute les alentours. Personne. Et en bas ? Son regard de milan embrasse le décor, lentement, fixant plusieurs points, cherche l’éclat d’une paire de jumelles. Rien. Aucun mouvement, le silence approximatif d’une fin de journée, à peine compromis par les sept coups aigrelets du clocher.
Personne ne viendra ce soir. Cela n’augure rien de bon. Ils attaqueront demain à la première heure. En force. Lui, aura dormi d’un œil seulement, on ne sait jamais, ils seraient encore capables de tenter un assaut de nuit, et tant pis si leurs lampes- torches les trahissent. Sans doute sera-t-il plus fatigué qu’eux, d’autant qu’il n’aura rien avalé depuis des heures.
Trouver quelque chose à manger, mais où ? Inspectant les alentours, il tombe sur ce qu’il reste d’un lièvre qu’un renard ou un chien errant a dû abandonner là après avoir dévoré les meilleurs morceaux. Par chance une partie des râbles est intacte. Des fourmis commencent à se les approprier.
« Saloperies, dégagez de là ! » gronde Mathias en soulevant la petite carcasse.
La chair ne sent pas très bon. Tant pis, il va falloir faire avec. Mathias réunit du petit bois et des cailloux qu’il dispose en cercle, glisse les bûchettes au milieu et y met le feu avec son briquet. Une brassée de fougères désagrège le mince filet de fumée – surtout, ne pas se faire repérer par quelque « sentinelle » capable d’être grimpée au haut de l’église pour inspecter les environs pendant que la lumière le permet encore –tout en attisant les braises. En finir le plus vite possible avec la cuisson.
Le morceau est un peu ferme mais n’a pas mauvais goût ; Mathias le dévore à belles dents, vide la bouteille d’eau qu’il trimballait dans son sac. Elle est presque chaude. Des framboises sauvages, aperçues un peu plus loin, lui feront un dessert. Il les déguste une à une, en prenant le temps de les faire rouler dans sa bouche, comme il le faisait lorsqu’il était môme. Adossé au rocher qui rappelle un menhir, il interroge le ciel que les flaques violacées de la nuit envahissent. Bientôt, il ne reste plus rien de la dernière clarté du jour. L’étoile du berger pointe, suivie d’une autre, puis d’une troisième. La nuit devrait être belle, mais fraîche. Un vent léger agite les herbes, les fleurs, les feuillages alentour. Mathias avise un bouquet d’arbrisseaux à une dizaine de mètres. C’est là qu’il décide de s’installer pour dormir. Il réunit des brassées de fougères mêlées à de l’herbe et à un restant de fourrage oublié là, cela lui fera un lit acceptable. Il en a connu de plus rudes. Il extirpe de son sac le seul pull qu’il possède, l’enfile puis s’allonge sous son blouson et le plaid qui l’a toujours suivi dans ses pérégrinations.
Pour se rassurer, il met la main sur le vieil automatique espagnol que son grand-père lui avait donné. Il ne l’a utilisé qu’une fois, pour tuer un lièvre. La balle était un peu trop grosse, Mathias avait eu l’impression de manger un plat qui avait trop mijoté, au point de ressembler à de la bouillie. Une dernière inspection du ciel où certaines étoiles clignotantes ressemblent à de mini fusées de feu d’artifice, les appels répétés d’un hibou, et Mathias tombe dans l’engourdissement qui précède le sommeil.