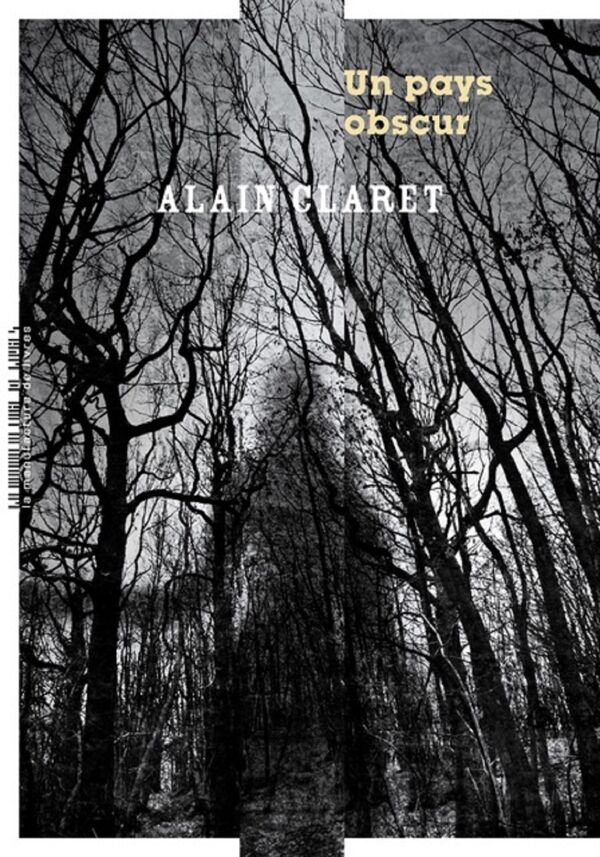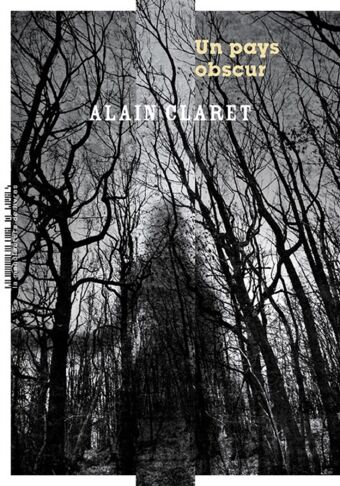
Alain Claret
Un pays obscur
La vie de Thomas bascule sur le front de Libye, dans les caves où il est retenu prisonnier et attend d’incertaines tractations politiques. Ce sont des mois de solitude loin de la lumière du jour, avec ses souvenirs pour seul soutien. Après, ce sera pour le jeune journaliste le difficile retour au monde, la maison de son père où il se réfugiera, face à une mystérieuse forêt. Là, il tentera de reprendre pied. Mais c’est sans compter sur d’étranges disparitions de femmes et sur le retour dans sa vie de Hannah, son amour passé, qui se débat avec ses propres démons.
Dans ce roman addictif, Alain Claret nous entraîne en ce pays obscur où les fantômes du passé et les ombres du présent se lient pour brouiller toutes les pistes et mettre sans relâche la raison à l’épreuve.
Quelle claque ! Voilà un très très grand roman. Ce livre est addictif par son écriture, par sa construction et par son drame émouvant. C’est un réel plaisir de lecture qui nous laisse groggy. Un auteur à découvrir ! Mon grand coup de cœur de cette fin d’année 2018.
Un pays obscur ne peut laisser indifférent. L’écriture est magnifique, l’histoire on ne peut plus noire, un livre dérangeant, donc un livre brillant.L’auteur réussit un mélange saisissant entre l’évocation extraordinairement sensuelle du monde et l’univers ténébreux et toxique de l’esprit, à la limite du fantastique, servi en cela par une langue raffinée et subtile.Ce roman noir n’est pas traditionnel. Avec une finesse saisissante, Alain Claret nous immerge dans une atmosphère troublante, où rien n’est sûr, où tout devient suspect…Les personnages sont parfaitement convaincants, on s’y attache, on les déteste, ils créent un subtil mélange de doute et de mystère dans notre esprit. L’écriture achève de nous emporter dans un brouillard sombre et obscur. Un pur plaisir de lecture.Un roman noir hors catégories. Laissez-vous prendre par une écriture d’une grande qualité littéraire dans le pays obscur des mystères de l’âme, entre passé et présent, vérité et mensonge. Absolument captivant !- téléchargez l’extrait
La lune sortit d’un nuage et il vit la tête de son compagnon partir violemment en arrière ; ses yeux gonflèrent sous le choc, le haut du crâne se déchira et un flot de sang fusa dans l’air saturé de poussière. En même temps, Thomas regardait fixement la lucarne tachée de lueurs jaunes qui se découpait dans le toit et il comprit qu’il était dans sa chambre et qu’il ne craignait rien.
Il songea au regard bleu de son compagnon qui avait surgi de son crâne comme d’un volcan et il se rendormit.
Un peu plus tard c’est le tacatac sourd de la mitrailleuse de.50 qui le réveilla, les douilles brûlantes lui tombaient sur le dos et les épaules alors qu’il avait la tête dans le sable ; la poussière et la peur lui piquaient les yeux, la hanche de son compagnon se pressait contre sa cuisse et il sut qu’il ne se rendormirait pas.
La lune était entrée dans la chambre, le faisceau de lumière était froid comme l’intérieur de son corps. Il se tenait raide sous la mince couverture, le silence était si dense qu’il eut la sensation que du temps brut s’écoulait dans la pièce. Du temps, hors la vie, hors la mémoire, qui avançait des origines passant sur lui comme un orage sur un vêtement oublié sur un fil.
Regarder l’heure ne servirait à rien. Il renonça à dormir.
C’était les Forces Spéciales Libyennes qu’ils avaient eues en face d’eux, des soldats aguerris qui étaient sortis du désert dans leurs 4x4 couverts de peintures de camouflage. Mais les Rebelles étaient confiants à cause de leur mobilité et de la mitrailleuse de.50. Ils la mirent en position à l’entrée du village et scrutèrent le ciel à la recherche des avions de l’OTAN. Le ciel était vide et le soleil frappait le visage fatigué des hommes, faisait flamber les dents blanches dans leurs grimaces : des paysans, des boutiquiers, des jeunes Chabab, le torse ceint de cartouchières. Ils racontaient que Kadhafi donnait du viagra à ses troupes pour qu’ils soient plus féroces et violent leurs femmes, ils juraient en enveloppant la.50 de chiffons d’huile pour que le sable ne la grippe pas. C’était une bonne arme, il l’avait vue à l’œuvre à Misrata. Une.50 en enfilade dans une rue et plus rien ne passe, il faut attendre les chars ou l’aviation.
Il sortit les jambes du lit, posa les pieds sur le tapis et resta les coudes sur les genoux à regarder son ombre se découper sur le mur et à réfléchir à ce qu’il ressentait. C’était difficile et ça occupait ses jours et ses nuits depuis son retour.
Le jour, il avait l’impression de bander ses forces pour affronter les gens et la vie qui l’entourait, la nuit il revivait ce qu’il avait vécu. Les insomnies étaient bizarrement ce qu’il y avait de mieux. Au début, il dormait à l’hôtel ou chez des gens mais c’était pire alors il était revenu dans cette maison qui avait été le refuge de son père. La maison le réveillait comme une vieille amie qui se trouve délaissée.
La lune éclairait l’oreiller comme une page blanche. Sa tête et ses pensées n’y avaient rien laissé : des plis et de la sueur. Il essaya de penser à une femme qui y aurait posé la sienne, des vers que lui disaient son père lui revenaient par bribes : écho, parlant quand bruit on mène…
Le sniper avait touché son compagnon en premier. Le petit groupe de Rebelles qu’ils accompagnaient avait atteint le village à la faveur de la nuit, avançant à travers la ligne de front qui se déplaçait sans cesse. Ils avaient deux voitures bringuebalantes et une radio R-111 russe de 45 kg installée dans la benne du pick-up. Les Rebelles renseignaient comme ils pouvaient l’arrière des mouvements des Loyalistes. Ils cherchaient les colonnes de chars, l’artillerie mobile et tout ce qui pouvait servir de cible aux bombardiers de l’OTAN.
Il avait rencontré Tom sur le port de Benghazi où tout le monde se croisait devant les ferries à la recherche d’informations, de contacts ou de ravitaillement. Ils étaient là pour les mêmes raisons, ils s’étaient liés d’amitié. Tom était Écossais, plus jeune que lui d’une dizaine d’années, il était photoreporter indépendant et depuis dix ans couvrait tous les conflits de la planète. Il se méfiait des médias traditionnels, des rédacteurs en chef qui vous envoient chercher le scoop et les images qui font l’ouverture du journal de 20 heures. Il était là pour rester, se faire une idée, vivre la guerre avec les hommes qui la font. Il filmait peu, photographiait encore moins, il discutait, réfléchissait, découpant au scalpel le matériel dont il avait besoin pour raconter ce qu’il voyait.
Quelques jours plus tard, Thomas avait expliqué à Tom le boulot qu’il faisait depuis un moment à essayer d’infiltrer les conseillers militaires qui commençaient à grouiller sur les théâtres d’opération. Lui non plus n’était envoyé par personne, il faisait un travail d’investigation qui nourrirait plus tard un long exercice d’écriture. Il le fit rire en lui racontant comment il avait couru derrière le Sénateur McCain lors de sa visite à Benghazi pour lui arracher la déclaration qui avait fait le tour des agences : « Ils ont besoin d’armes et d’entraînement. »
Ils entendaient des tirs de Kalachnikov par-dessus les bruits de la circulation, dans le café où ils étaient personne ne releva la tête. La ville était remplie d’armes ; quelquefois les gens tiraient en l’air par plaisir ou par tristesse. Thomas avait dit à Tom qu’il avait du mal à comprendre le travail que faisaient tous ces types ; français, anglais, américains. Ils étaient discrets, habillés en civil, équipés d’armes légères. Ils affirmaient ne pas appartenir aux Forces Spéciales, ni aux services de renseignement, ils disaient venir du Génie, des Transmissions, pour faciliter l’acheminement de l’aide alimentaire et médicale.
– Est-ce que tu essaies de comprendre cette guerre ? lui avait demandé Tom.
– J’essaie toujours de comprendre.
– Il n’y a rien à comprendre.
– Alors, qu’est-ce que nous faisons ici ?
– On peut montrer ce qui se passe, on peut montrer des choses que personne ne comprend.
– Tu as raison.
– Demain je pars avec un groupe de Rebelles sur le front, viens avec nous…
Les Loyalistes avaient dû les repérer car ils restèrent à distance et déclenchèrent un tir de mortier sur le village. Les habitants se mirent à fuir vers le désert qui n’offrait aucune protection, les Rebelles s’enterrèrent loin des maisons qui s’écroulaient comme des châteaux de cartes. Thomas vit un homme sauter dans un puits aussitôt recouvert d’une montagne de gravats. La poussière les dissimulait, ils avaient rampé vers la mitrailleuse que deux Rebelles mettaient en batterie en criant « Allah Akbar ». Tom lui dit qu’un habitant avait dû voir la radio et prévenir les Loyalistes avec un téléphone portable : « ils ont des espions partout. » Ce furent les dernières paroles qu’il lui adressa. La.50 se mit à tirer. Il vit Tom littéralement plonger avec sa caméra au-dessus de l’épaule du tireur et filmer dans la poussière, tendu, raide, le visage crispé, les douilles volant autour de lui. Tom et le Chabab avaient l’air attelés à un char furieux qui essaierait de traverser un mur. Les salves de mortier cessèrent presque aussitôt, la.50 rugissait dans une odeur de poudre et d’huile brûlante puis tout s’arrêta, quelque chose brûlait derrière eux et une fumée grasse les avait recouverts.
Quand il se retourna il vit les deux pick-up en feu et des corps étalés entre les maisons. Ils avaient l’air de paquets de guenilles sanglantes, de petits tas qui fumaient comme des braseros. Plus rien ne bougeait, il sentait la hanche de Tom contre sa cuisse, il était allongé sur le dos, son regard bleu perçait une croûte de poussière et de sueur qui lui faisait un masque halluciné. Il souriait, il ressemblait à Willem Dafoe dans Platoon.
La balle le toucha sur le haut du front, sa tête claqua en arrière, le regard bleu gonfla et toute trace d’humanité y disparut brutalement ne laissant plus qu’un magma informe puis l’arrière du crâne fusa dans le sable. Une seconde balle traversa le dos du servant de la.50 et le projeta sur Thomas. Il n’entendait aucune détonation, seulement le sifflement des balles et les impacts qui touchaient les corps. Le sang du Chabab lui inondait le cou.[1]
Il quitta le lit et alla ouvrir les volets. La fenêtre donnait sur un jardin plongé dans le noir. L’air était doux, de grandes masses d’ombre assiégeaient la maison puis la lune déchira un nuage et il vit des arbres, des buissons, des épais massifs de végétation qui faisaient des murs vivants et profonds. Quelquefois, il pensait que Tom attendait dans le jardin, assis sur un coussin d’herbe, patient, concentré sur une idée fixe. Il attendait qu’il le rejoigne et lui explique ce qui était arrivé. Il contemplait un moment le jardin et refermait la fenêtre en se disant qu’il n’y avait rien à comprendre.
Il aurait aimé mieux connaître Tom. Il y avait continuellement pensé après qu’il fut fait prisonnier. Ce fut comme si Tom eut soudainement remplacé tous les gens qu’il connaissait et ceux qu’il aimait. Il ne savait rien de lui, il connaissait un peu son travail, il l’avait même croisé un jour dans un festival où il présentait un film qu’il avait tourné dans les montagnes d’Afghanistan : un grand type en costume qui répondait aux questions avec un sérieux étonnant. Mais Tom n’était alors qu’une figure de ce métier qu’ils faisaient tous avec circonspection. La quinzaine de jours qu’ils passèrent dans le désert libyen avait fait naître une complicité qui avait été brutalement brisée. Il aurait pu devenir un ami si la vie leur en avait laissé le temps. Qui était-il ? Il avait laissé sur le sable un corps sauvagement détaché du monde. Qu’avait-il emporté ? Qu’avait-il laissé ?
Les soldats avaient envahi le village. Ils avaient immédiatement abattu tous ceux qui portaient une arme. Les snipers tiraient sur les fuyards qui couraient vers l’horizon, tuant tout ce qui bougeait : animaux, enfants, femmes qui tombaient en laissant sur la terre aride les larges taches de couleur de leurs habits. Ils réunirent les femmes et les enfants cachés dans le village sur un terre-plein de cailloux brûlant, enfermèrent tous les hommes dans une remise, les mains attachées dans le dos, un bandeau sur les yeux. Il n’avait pas bougé sous le corps du servant de la.50 qui l’imbibait doucement de sang et de l’idée de la mort. Il entrevoyait le cadavre de son compagnon mollement allongé sur la terre, un bras cachant son visage détruit, une main tendue vers ce monde qu’elle venait de quitter.
Il songea à ce que lui avait dit cette femme qui traversa un moment sa vie : le corps contient le temps, c’est pour cela qu’on peut désirer un être longtemps. Dans l’amour, il n’y a pas de jeunesse ou de vieillesse, il n’y a que cette continuité qui ne se dérobe jamais.
Peut-être aurait-il pu échapper à ce qui l’attendait mais les soldats découvrirent la caméra de Tom au pied de la mitrailleuse et se mirent à pousser des cris de victoire. Ils traînèrent les corps par les pieds et crurent d’abord qu’il était mort, son cou et sa poitrine étaient couverts du sang du servant. Quand ils comprirent qu’il était vivant, ils le rouèrent de coups de pied et arrachèrent de ses poches tout ce qu’elles contenaient. Puis ils le mirent à genoux sur le sable, tête baissée, un fusil sur la nuque.
Thomas quitta la chambre pour aller dans le bureau chercher des cigarettes. Il s’était remis à fumer et c’était la seule chose qui le reliait à sa vie d’avant. Comme si cette longue interruption n’avait été qu’une tentative vaine de devenir un autre. Comme toujours, il entra dans le bureau avec appréhension ; une pièce où l’avenir n’était jamais sûr : un lieu déstabilisant que seule la volonté faisait exister. Il trouva les cigarettes sur la table où il les avait laissées, il les prit avec reconnaissance. Il les avait posées là le soir, elles étaient encore là. Tout le monde arrêtait de fumer, tout le monde pensait être libre de faire ou de ne pas faire les choses. Il alluma le briquet, la flamme éclaira ses mains qui tremblaient.
Le souvenir du poids du fusil sur sa nuque avait peu à peu disparu mais ce qui était resté, c’était la sensation à ce moment-là que quelque chose quittait son être et ne reviendrait pas. Quelque chose qui s’enfuyait pour aller se dissimuler au milieu des morts et mourait à son tour pour reproduire ce qu’il y avait autour d’eux. Le corps de Tom était posé comme un paquet sur le sable, il semblait en avance ou arrivé avant lui à leur destination. Les soldats gueulaient dans un sabir anglais : « YOU FRENCH ! YOU FUCKING SPY ! YOU DEAD ! YOU FUCKING DEAD FRENCH ! » Ils faisaient cercle autour de lui ; ils riaient, le giflaient, le bas du visage recouvert d’écharpes vertes qui s’enfonçaient dans leur veste de treillis, les mains pleines d’armes ; de fusils d’assaut, de lance-roquettes, de longs poignards affûtés comme des rasoirs. Des regards hallucinés qui brûlaient dans leur peau sombre ou couverts de lunettes noires de jeunes types à la mode : « YOU FUCKING FRENCH ASSHOLE ! » Ils brandissaient leurs armes, posaient un pied victorieux sur le corps de Tom : « FRENCH SPY ! » Il répétait qu’il était journaliste, qu’il était reporter de guerre jusqu’à ce qu’un officier s’approche, lui dise que ce n’était pas sa guerre et lui balance un coup de casque qui l’envoya rouler sur le sable.
Thomas s’assit à la table, la cigarette rougeoya devant son visage, il allongea ses pieds et ses jambes nues, l’odeur du tabac donnait à la pièce un semblant d’intimité et son corps se détendit un peu. Il fumait sans bouger, un long cylindre de cendre pendait au bout de la cigarette et tomba sur ses genoux. La cigarette se consuma sans qu’il fit d’autre geste qu’aspirer et souffler la fumée puis il écrasa le mégot dans un cendrier.
Il s’était réveillé au milieu des autres hommes dans la remise, les mains attachées dans le dos, un bandeau sur les yeux. Sa tête pulsait de douleur et la nausée le faisait trembler. Les soldats gueulaient autour de lui, les hommes du village leur répondaient avec de longs discours mêlés de sanglots. Les coups sourds des armes automatiques ponctuaient les cris et les prières, l’air étouffant chargé de l’odeur cuivrée du sang et de la peur. Il savait ce qui se passait ; les soldats punissaient le village d’avoir accueilli des Rebelles, ils allaient enrôler de force les paysans et tuer ceux qui résistaient ou refusaient. Le silence s’était fait peu à peu dans la remise, après il entendit les cris des femmes. Il s’était évanoui ou endormi quand son corps se vida de sa nausée.
Il alluma la lampe sur le bureau. La war room surgit du noir, sur le mur une carte de l’IISS affichait les conflits en cours dans le monde, à côté une feuille était punaisée où il avait écrit en capitales une citation de Bob Woodward, le journaliste vedette du Washington Post : « Avons-nous fait notre boulot de journalistes ? Ma réponse est un NON géant. » Sur la carte était scotchée une photo de Tom, découpée dans un journal ; mal rasé, en chemise ouverte sur un tee-shirt, la courroie de son appareil photo passée autour du cou. Des piles de livres, d’articles, de photos étaient étalées sur la table, des tasses et quelques objets qui détonnaient au milieu des papiers : un sécateur, une serrure démontée, une réplique du Colt de la cavalerie américaine de 1873 trouvée dans les affaires de son père, et sa devise : Dieu a créé les hommes, Samuel Colt les a rendus égaux.
Les soldats étaient revenus dans la remise et lui avaient arraché son bandeau. Des corps tordus jonchaient le sol, le sable était rouge de sang, des nuages de mouches vrombissaient au-dessus des cadavres. Ils lui crachèrent à la figure et le poussèrent dehors. Il tomba deux fois, ils le relevaient et finirent par le traîner en repoussant les cadavres à coups de pied. La lumière lui enfonça ses griffes derrière les yeux. Les femmes pleuraient, serrées les unes contre les autres, recouvrant les enfants des pans de leurs vêtements. Une file de paysans était alignée devant un camion, surveillés par des hommes en armes, résignés, leurs mains tenant des baluchons ou des bouts de corde où étaient attachés des chèvres et des moutons. Ils le firent monter dans la benne d’un pick-up à côté d’un corps couvert d’une bâche. La caméra de Tom était posée dans une caisse au milieu de bandes de munitions de 12.7. Le moteur tournait, un soldat amena une femme vêtue d’un tchador marron qu’elle retint entre ses dents pour grimper dans la voiture. Le soldat monta à son tour et ferma la ridelle.
Il fit le voyage en scrutant les yeux de la femme assise face à lui qui se retenait machinalement au cadavre de Tom dans les chaos. Son regard était sombre, bordé de khôl, et semblait perplexe. Elle le dévisageait avec son air de madone en tenant les plis de son voile autour de son visage, sa main tatouée de signes au henné. Il se demandait qui elle était, pourquoi les soldats l’avaient embarquée avec lui. Était-elle un de ces espions dont avait parlé Tom ? Ou faisait-elle partie du butin avec les chèvres et les moutons ? Ils roulèrent des heures avec de nombreuses pauses où le chauffeur attendait d’énigmatiques instructions. Ils formaient une équation complexe où chaque partie conservait son mystère : lui, le soldat, la jeune femme et le mort.
Est-ce qu’il avait peur ? Sans doute, mais il commençait à ressentir ce détachement où il n’arrivait plus à faire la part de ce qui relevait de lui et de la puissance dévastatrice des autres.
Il réveilla l’ordinateur sur le bureau, il avait un nouveau message dans sa boîte mail. Il contempla la ligne noire qui se détachait des autres courriers déjà avalés par le temps puis leva la tête sur la photo de Tom et la carte accrochées au mur, comme un marin qui cherche un signe à l’horizon. Hannah Morgenstern, le message était étrange, là, inscrit au milieu de la nuit : 23 h 58 – Bonsoir.
Il n’avait eu aucune nouvelle d’Hannah Morgenstern depuis plus de dix ans. Le nom évoquait une époque révolue. Il se laissa aller en arrière sur le fauteuil et son esprit commença à analyser les quelques informations qu’il avait : elle avait écrit aux alentours de minuit, un peu tard pour un message qui n’était pas personnel. L’objet « Bonsoir » renforçait cette idée d’intimité qui n’avait pas lieu d’être après dix ans de silence. L’adresse @loufried.com était un domaine professionnel, Loufried : la paix de Lou. Le mot lui évoquait vaguement quelque chose.
Il se leva, fit le tour de la table et se planta devant la carte. Les zones de conflits étaient classées par degré d’intensité : combats armés fréquents, combats armés sporadiques, accrochages occasionnels, instabilité. La carte était parcourue de flèches qui indiquaient les routes que prenait la drogue et ses liens géographiques avec les zones de conflits. La carte du monde était zébrée, hachurée, tachée de couleurs d’incendie ; du rouge au jaune, ponctuée d’éclairs qui indiquaient les zones d’attentats. Le monde était en guerre. La photo de Tom était collée à l’emplacement de la Libye. Thomas avait tracé des lignes rouges qui partaient de la photo jusqu’aux conflits qu’il avait couverts : Proche-Orient, Afrique et Grands Lacs, Caucase, Irak, Afghanistan et Pakistan. Il regarda le visage de Tom qui ne ressemblait pas à celui qu’il avait connu. Il revit son ami qui souriait, la poussière collée dans ses rides joyeuses, ses yeux délavés comme le tissu de sa chemise.
Il retourna au fauteuil et s’assit devant l’écran avec l’impression qu’il pénétrait dans une des zones blanches de la carte exempte de conflit : Hannah Morgenstern – Bonsoir. Il allongea le bras et tira vers lui la serrure démontée sur une feuille de journal luisante de graisse. Il entreprit patiemment de la remonter en songeant qu’il avait été très amoureux d’elle. Elle avait trente ans à cette époque, elle était belle et malheureuse, ils avaient eu une liaison brève que le vocabulaire de la carte qualifierait de haute intensité, il avait découvert à ce moment-là des choses sur lui et sur le corps des femmes. Il essaya de se souvenir s’il avait pensé à elle durant ses longs mois de captivité. Il avait pensé à beaucoup de choses mais pas à elle.
Il referma le capot de la serrure, remit les vis en place et constata avec satisfaction que la clef jouait avec un bruit de mécanisme bien huilé. Il la reposa sur le journal et la regarda longtemps en se rappelant le grincement de celle de sa prison. Elle ne s’ouvrait pas tous les jours, il était resté prisonnier pendant plus de huit mois, c’était un bombardement de l’OTAN qui l’avait libéré.
Le chauffeur les avait conduits, lui, le soldat, la femme et le mort, à Misrata que les Loyalistes avaient repris aux Rebelles une semaine auparavant. Aux abords de la ville des carcasses de chars, de véhicules blindés, de batteries antiaériennes montraient la violence des combats qui s’y étaient déroulés. Les troupes avaient enfoncé la ligne des Rebelles et les avaient repoussés à une trentaine de kilomètres vers l’est, en plein désert. Les Rebelles avaient dénoncé les massacres qui avaient suivi l’entrée des troupes dans la ville et accusé l’OTAN de les avoir laissés tomber. Quand il avait rencontré Tom, il revenait de Misrata. Thomas avait quitté la ville au début du siège, au milieu des Rebelles qui se repliaient en désordre, mal armés, désorganisés. Il était retourné à Benghazi sur un bateau qui convoyait les blessés et les réfugiés qui fuyaient les bombardements. Tom avait assisté aux combats avec un de ses collègues photographe qui avait été tué d’un tir de mortier, Tom lui avait dit qu’il avait eu de la chance ce jour-là.
Le chauffeur fit descendre la femme dans un quartier d’immeubles modernes qui était rempli de soldats. Les rues étaient encombrées de voitures abandonnées, les trottoirs maculés de taches de sang et de débris. La femme serra son voile et s’éloigna au milieu des soldats qui l’interpellaient et lui faisaient des signes obscènes. Elle disparut dans les décombres vides et béants des immeubles.
Un peu plus tard, les soldats l’obligèrent à porter le corps de Tom et à poser avec son cadavre pour des photographies. Ils l’interrogèrent dans une pièce borgne devant des écrans qui diffusaient des reportages de CNN et d’Al Jazeera. Leurs cartes de presse étaient posées sur la table, devant un officier, au milieu d’objets volés dans les appartements abandonnés. La pièce était remplie de meubles et de bric-à-brac tirés de leur pillage. Ils le frappèrent et prirent des photos de son visage tuméfié. Ils le photographièrent devant un drapeau libyen, un pistolet sur la tempe et un journal ouvert sur la poitrine qui montrait des portraits de Sarkozy et d’Obama. Puis ils l’enfermèrent dans une cave de l’immeuble. Des plaintes et des appels montaient derrière les portes.
L’ordinateur s’était remis en veille, effaçant le nom d’Hannah Morgenstern. Un merle dans le jardin faisait ses trilles d’avant l’aube, trouant le silence comme une lame. Il éteignit la lampe et resta dans le noir à écouter et à s’éloigner sur le chant de l’oiseau, de tous et de lui-même.
La première chose que fit Thomas une heure après l’aube fut de remonter la serrure sur la porte du jardin. C’était une vieille porte en bois plein, accrochée par de gros gonds rouillés à un mur de pierre. Elle ouvrait sur un petit chemin de noisetiers et de charmilles qui longeait la maison. À gauche, il menait au hameau ; trois ou quatre maisons soigneusement restaurées par des cadres, puis vers à la ville à trois kilomètres où il y avait une gare qui pouvait vous emmener jusqu’en Libye. À droite, le chemin continuait à travers un fouillis d’herbages et de bosquets jusqu’à la forêt qui s’étendait sur des kilomètres. Il était emprunté par des bûcherons qui exploitaient le bois de la forêt et le dimanche par des groupes de randonneurs. Ils s’arrêtaient parfois pour photographier la maison, les buissons de chèvrefeuilles et de seringas ; les roses et les pois de senteurs qui embaumaient l’air. Dans ces moments, Thomas ne bougeait pas, comme un animal nocturne pris dans la lumière d’un phare, il respirait doucement, invisible derrière les fenêtres éclaboussées de lumière et de glacis verts et dorés ; il attendait que les voix et les exclamations se diluent dans le silence, s’éteignent avec le bruit des cailloux roulant sous les pas des marcheurs.
Il mastiqua les trous usés de la porte avec de la pâte à bois et fixa la serrure à son emplacement avec de grosses vis à tête plate qu’il avait acheté à la droguerie de la ville. L’air était frais, mouillé de rosé, le jardin sortait de la nuit, luxuriant, immobile dans son dos. Il n’y entrait qu’au petit matin ou le soir au couchant, le reste du temps il lui semblait occupé par une présence mystérieuse ; la nature était envahissante. Il n’y venait qu’aux heures intermédiaires, jamais longtemps et toujours pour accomplir quelque chose. S’asseoir, lire, boire un café ou un verre de vin était simplement impossible. Il se disait que parler à quelqu’un aurait été agréable.
La clef devait avoir plus de cent ans, elle tournait avec des claquements rassurants, il la laissa sur la serrure et la regarda, nue et luisante, bien en place dans son berceau de métal. Un jour, il avait perdu la clef, égarée quelque part dans le fouillis de la maison. Son père était entré dans une rage folle. Thomas n’avait pas compris ; ce n’était qu’une clef, on pouvait changer la serrure. Pendant deux jours, la clef avait gâché sa visite, la colère et la rancune du Vieux empoisonnaient l’atmosphère, il redevenait un gamin qui a fait une bêtise.
Qu’est-ce que tu avais besoin d’emporter cette clef, elle reste toujours au même endroit.
J’ai dû la poser quelque part.
Tu l’as perdue dans la forêt, tu ne pouvais pas passer par-devant ?
Je vais la retrouver.
Elle est perdue nom de Dieu ! Tu ne comprends pas que tu l’as perdue ?
Il l’avait retrouvée en faisant ses bagages. Les mains encombrées, il l’avait posée sur l’étagère de la remise où on rangeait les bottes et chaussures de marche. Il l’avait tendue à son père alors qu’il avait son sac sur le dos pour se rendre à la gare. Le Vieux l’avait prise avec un étonnement mêlé d’un peu de honte. Il était trop tard pour recommencer, pour refaire les choses mieux. Son père avait secoué la tête et ses yeux contenaient une leçon de tristesse : on n’est pas libre, il y a des choses bizarres qui nous tiennent et réclament notre respect. À ce moment-là, Thomas croyait que c’était des histoires de vieux.
Son père était mort quelque temps avant son départ pour la Libye. Quand Thomas était prisonnier, des gens envahissaient ses pensées : des soldats, des prisonniers, des journalistes avec qui il avait travaillé, des combattants qui lui avaient livré des tranches de vie d’une incroyable brutalité et Tom qui était comme une étoile éblouissante. Son père mort s’asseyait tous les soirs dans sa cellule et déroulait un passé proche et rendu inaccessible. Il savait alors que c’était le soir car aucune lumière naturelle ne pénétrait dans ces lieux.
Il ramassa ses outils et entra dans la maison par la porte de la cuisine. Elle était comme le Vieux l’avait laissée à sa mort : de vieux éléments en bois patinés, une table de chêne avec un banc, une grosse cuisinière noire, impressionnante – son père aimait faire la cuisine et préparer des repas délicieux – une petite bibliothèque qui contenait des livres de cuisine, des guides sur les champignons, le gibier, des ouvrages sur le vin et le jardinage, un buffet rempli de vieilleries récupérées dans les brocantes. Le sol était couvert de vieilles tommettes usées qui conservaient le passage des occupants ; à un endroit légèrement enfoncées, là où des générations de bras avaient fendu des bûches pour les jeter dans le poêle. C’était une pièce familiale où l’on imaginait bien des enfants la traverser en courant pour foncer dans le jardin, des chiens couchés devant la porte, des jeunes filles relever leurs cheveux pour se donner à la lumière. Son père y avait vécu seul pendant plus de vingt ans.
Il rangea les outils dans le buffet et resta un moment dans la lumière grise à regarder dehors puis il mit la machine à café en route. C’était le moment qu’il préférait, la nuit était passée et la journée, à l’image de la lumière, encore indécise et neutre. Il tassa le café dans le filtre et ébouillanta la tasse d’un jet de vapeur. Son père appréciait les machines qui accomplissaient correctement leur travail ; l’appareil cliquetait sous la chaleur et répandait une odeur de brasserie. Est-ce qu’il avait parlé de son père avec Tom ? Non, mais il avait souvent évoqué avec son père, les êtres insolites qu’il croisait dans son travail. Assis à la table, devant un des plats savoureux qu’il préparait avec une aisance étonnante. Tom aurait apprécié son père, plus qu’il ne le faisait lui-même. Tom aimait les gens avec une facilité déconcertante.
Il verrouilla le filtre ; la pompe faisait un bruit impressionnant, le café coulait épais et moussu libérant son arôme. Il remplit la tasse aux trois-quarts, déverrouilla le filtre et le posa sur l’évier. Il prit un paquet de biscuit, traversa la bibliothèque et monta l’escalier pour gagner le bureau. Le haut de la maison était plongé dans le noir, conservait l’odeur des rêves et des cigarettes qu’il avait fumées, les planchers craquaient. Derrière les murs, les cris étouffés des oiseaux faisaient un bruit lointain et mourant comme si la maison s’éloignait doucement de la terre et des hommes. Il ouvrit les volets ; la lumière du jardin et du ciel força la nuit.
Il retrouva la carte et la figure de Tom et but son café et mangea les biscuits en étudiant les mouvements de la guerre sur la carte, observant les murs autour de lui comme si quelque chose essayait d’émerger du silence ; quelque chose de difficile et de violent. La nuit, la figure de Tom était amicale, le jour elle attendait et l’interrogeait crûment.
Il voulait écrire un livre qu’il ne comprenait pas. Ce qu’il savait de l’écriture, de la réflexion et de la vérité était mort avec Tom et enterré dans la cellule où il avait passé des mois. Il fallait qu’il comprenne l’homme qu’il était devenu. Parfois il pensait qu’il était mort là-bas et qu’il ne le savait pas.
Le café n’était pas celui d’un mort, il était bon, parfumé, mais il savait qu’il tirait sa force et son goût du passé et de la mémoire. Il se souvenait comment, à son retour de Libye, après l’effervescence, les questions, la chaleur des retrouvailles, il avait sombré dans le regard des autres. Alors il était venu se réfugier dans cette maison qui n’était pas la sienne.
Le bureau était la seule pièce qu’il avait aménagée, le reste était dans l’état où son père l’avait laissé. C’était la chambre du Vieux ; une grande pièce carrée avec des lambris sur des murs de pierre et un plancher pont de bateau avec des joints noirs. Son père ne mettait pas grand-chose dans sa chambre mais Thomas avait sorti les quelques meubles parce qu’il avait l’impression de voir l’intérieur de son crâne. Le Vieux avait acheté la maison à sa retraite lorsqu’il avait décidé de quitter la ville et d’abandonner la vie qu’il menait à Paris. Il était directeur des cours de Civilisation Française à la Sorbonne. C’était un homme fâché avec son époque, qui préférait Montaigne et Rousseau aux arguties du temps présent.
On eut dit que Thomas avait ajouté une couche de désordre à la sérénité qui se dégageait des pierres et des bois patinés, mais aussi qu’il avait libéré la longue file des existences prisonnières de ces murs. Son père avait placé son lit au milieu de la pièce et dormait dans le fil du temps comme au milieu d’un fleuve. Le matin, il jetait ses jambes hors du lit et trouvait ses pantoufles sur le tapis, les chaussait et inaugurait un nouveau jour. Thomas avait vidé la chambre, installé une table bientôt chargée de papiers ; les murs s’étaient couverts de photos et d’images de la violence qui encerclait les hommes. Il s’asseyait au milieu de la pièce comme au centre d’une île. Il n’avait touché à rien d’autre. De l’autre côté de la porte commençait le territoire des autres.
Il tira vers lui le dossier qui contenait les notes et les pages qu’il avait rédigées. C’était un gros volume qu’il maniait avec précaution ; la couverture griffonnée de noms et de numéros de téléphone. Il travaillait depuis trois mois et les pages s’accumulaient. Une partie renfermait les pages rédigées, propres, lisses, sans ratures, une autre bourrée de pages manuscrites, de photographies, de coupures de presses, de plans surlignés, fléchés, de dessins, d’articles et de photocopies de livres qui avaient plus ou moins de liens avec le travail qu’il menait. Il y avait même des choses qui n’avaient rien à voir mais qui étaient entrées par accident ou par une espèce de volonté inconsciente : des lettres qu’il avait reçues, des reproductions de peinture, des interviews d’hommes politiques et même des listes de course et des factures de restaurant. Quand il ouvrait le dossier, il ne voyait pas un livre en train de se faire mais une espèce de journal où chaque page renvoyait à un moment précis, une histoire de lui-même et de ses efforts ; ses interrogations, ses échecs, et la volonté qui le poussait à continuer.
Les gens du métier s’attendaient à ce qu’il écrive un récit de sa captivité, plusieurs journaux et éditeurs l’avaient approché, mais il en était incapable. Il voulait écrire l’histoire de Tom. Il voulait se plonger dans la vie d’un homme qu’il ne connaissait pas, qu’il avait côtoyé brièvement et qu’il avait vu mourir à ses côtés. Il voulait écrire une histoire qu’il ne comprenait pas sur un être qui avait traversé sa vie comme un météore et l’avait jeté hors du monde. Il voulait écrire la Légende de Tom et du monde dans lequel il vivait.
Il avait commencé par le récit de sa mort : une histoire de guerre. Rédigé des pages qui racontaient ce qu’ils avaient vécu, d’autres avec ce que lui avait dit Tom de ses expériences et de son métier. Il remontait le fil, de sa naissance à Édimbourg jusqu’au moment où il avait vu ce corps désarticulé, vidé comme un sac sur le sable. Il voulait parler du temps et de l’incompréhensible voyage qu’on y faisait.
Mais il n’arrivait pas à sortir de la cellule de Misrata. Quelquefois, les soldats venaient et tiraient un prisonnier de sa cave, ils le conduisaient dans une cour entre les immeubles et l’assassinaient. Quelquefois, il entendait un homme blessé geindre et appeler jusqu’à ce qu’il meure. Les soldats sortaient le corps et le remplaçaient par un autre. Quelquefois, les soldats venaient le chercher et le conduisaient devant un nouvel officier qui l’interrogeait sur ses contacts en France et le filmait en lui faisant lire un texte qui réclamait l’abandon des bombardements et l’ouverture de négociations. Une fois, deux soldats l’avaient conduit dans un appartement dévasté où un prisonnier était attaché sur une chaise, le visage et la poitrine marqués de coups. Ils avaient dit à Thomas que ses contacts ne marchaient pas et qu’ils allaient le tuer. Ils l’avaient placé face au prisonnier en lui disant qu’il pouvait sauver sa peau en abattant l’homme. Ils lui avaient collé un pistolet dans les mains. Ils parlaient en anglais et en arabe, ils braquaient leurs armes sur lui, un soldat filmait la scène. Il avait dévisagé le prisonnier qui pleurait, gémissait. Le pistolet pendait lourdement dans sa main. Cela avait duré une éternité, il pensa alors à la réponse de Tom lorsqu’il lui avait demandé s’il n’avait jamais peur : ne me demande jamais de te parler de ma peur… Le soleil entrait par la fenêtre détruite derrière le prisonnier et l’inondait d’une lumière brûlante ; son regard flottait à la surface du feu. Thomas leva les yeux et plongea dans la lumière. Il s’imagina qu’il nageait, qu’il s’éloignait, qu’il s’abandonnait à la douceur d’un jour d’été, la main de sa mère sur sa poitrine qui le soutenait et le guidait devant une mer immense. Il laissa tomber le pistolet qui coula vers le fond strié d’or et de nervures d’argent. Une rafale projeta violemment l’homme et sa chaise contre le mur.
Changement de chapitre