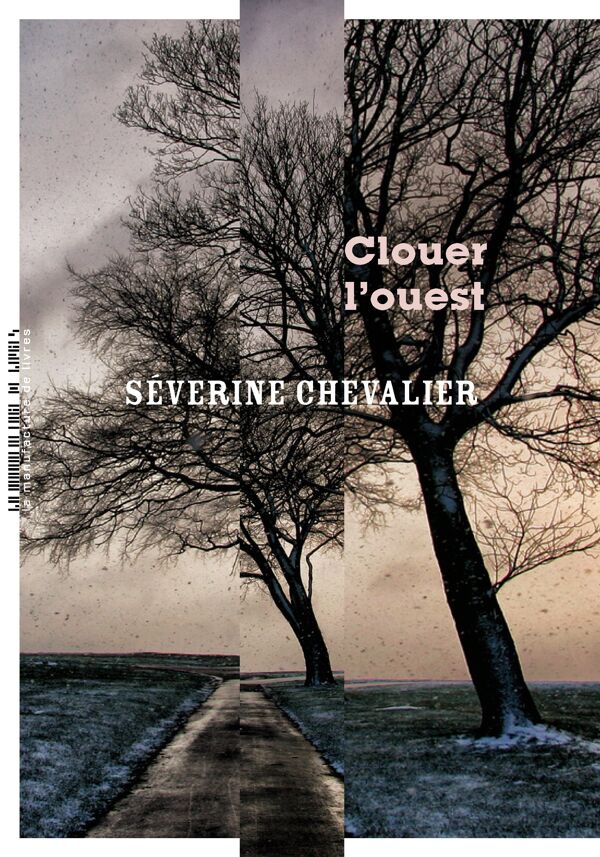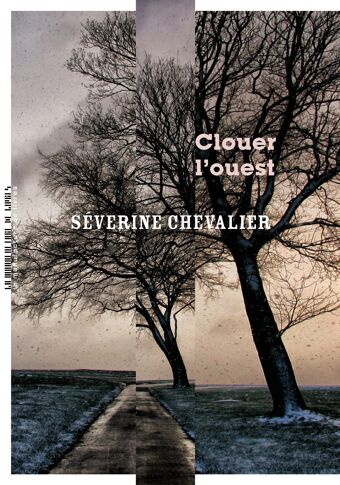
Séverine Chevalier
Clouer l’Ouest
Cela faisait vingt ans que Karl n’avait pas remis les pieds chez les siens. Amenant avec lui sa petite fille et ses dettes de jeux, il revient à la ferme familiale où nul ne l’attend plus. Ici, les secrets et les blessures du passé semblent avoir définitivement dressé des murs entre les hommes et les deux nouveaux arrivants vont remettre en question le fragile équilibre de ces vies. Et, pendant ce temps dans la forêt obscure et enneigée, une bête rôde.
Véritable bijou ciselé et poétique, Clouer l’Ouest révèle une voix unique et témoigne de l’infini talent de Séverine Chevalier à dire les drames et les rêves qui font le cœur de l’humain.
Ce livre est réédité dans le cadre de l’opération “10 ans, 10 livres” de La Manufacture de livres.
- Revue de presseIl faut peu de mots pour dire le monde, les regrets, les occasions manquées et les sentiments trop retenus. Il suffit, mais c’est une montagne à gravir, de choisir les bons mots, de les placer au bon endroit, de les ordonner avec le bon tempo.Écriture sèche, verbe aride, intrigue impitoyable : Clouer l’Ouest résonne comme une tragédie grecque.Une impressionante originalité d’écriture.Incontestable réussite, ce second roman mérite que l’on profite de sa réédition pour s’en emparer et lui donner la résonance à laquelle il peut prétendre.
Chronique intégrale - téléchargez l’extrait
Il faut bien que les choses se soient passées d’une certaine façon. Longtemps je ne me préoccupais pas de la scène blanche. Elle me hantait en sourdine et je faisais taire ses murmures, ou les laissais cogner, légers, aux parois d’une minuscule boîte, enfouie au plus profond de moi. Les bourdonnements de l’extérieur remplissaient leur office de fossoyeurs efficaces, diligents. Je ne savais pas qu’alors, les cadavres refusaient de se décomposer.
Je n’ai que des sensations de forêt sous la neige. C’est peu. Il y a du blanc et des arbres noirs. Maintenant je regarde la mer – j’y vis, droit devant – et il suffit d’un peu trop de soleil, d’une certaine illumination de sa surface bleu nuit, pour que se superposent du blanc et des membres décharnés, sombres, tendus vers le ciel. Il faut bien, que les choses se soient passées d’une certaine façon. Les choses. Des choses ayant à voir avec lui.
Avec un père et ses satellites-fantômes, reconstruits.
Plus j’y pense et moins je vois de différences entre une personne dont on pourrait attester de la vie réelle, vécue, et un personnage de roman. C’est sans doute une réflexion banale, mais pour ma part j’ai longtemps pensé le contraire, bien que si on se rapporte à l’importance que certains êtres peuvent avoir dans notre vie, j’en compte au moins autant, si ce n’est plus, de fictifs que de non-fictifs. Car on ne sait pas, pour les substances. Il n’y a rien qu’on pourrait exhaustivement démonter. Pas de clef universelle qui ouvrirait à un mode d’état et d’emploi – prévisions sensées, coordinations opérantes, cohérences explicatives qui illumineraient les vies. On ne sait pas, et pourtant, parmi l’infini des possibilités, les choses se passent d’une certaine façon. Et il ne suffit pas d’avoir été protagoniste ou témoin, pour savoir, comment les choses se passent. Sans doute est-ce toujours une combinaison d’hypothèses, de suppositions, de prélèvements ; une articulation subtile entre ce qui semble être et ce qu’on imagine ; la manière propre de fomenter nos récits, tous ces dispositifs préalables invisibles qui orientent, lient et relient, structurent les fragmentations. Il faut bien que les choses se soient passées, d’une certaine façon.
J’ai cinq ans et je suis seule, dans la forêt. J’ai froid aux pieds. Je tiens à la main un arc en plastique rouge rafistolé avec du scotch. Il y a du blanc et des arbres noirs, puis deux détonations, au loin. Deux en une. C’est tout.
J’ai attendu pas mal d’années, mais aujourd’hui, je crois qu’il est temps. J’avais d’abord jeté des mots comme pour constituer des préhistoires, sonder les traces qui resteraient de son enfance. Puis j’ai cru devoir enquêter, traquer, suivre des pistes, toutes m’ont réduite au silence. Enfin, j’ai décidé de me raconter une histoire, une histoire possible de son histoire et de la mienne, et peut-être quelqu’un la lira-t-il, un inconnu d’ici, de la ville et de la mer, du goudron sale et de l’eau qui submerge, si loin si près d’un lieu d’arbres et de terre. Immobile. Bruissant.
Intact.
Un jour
Pierre arrache l’oreille de Karl avec ses dents. Le bout il le recrache en même temps que le chewing-gum rose pâle, les deux tombent au ralenti dans les herbes jaunes. Ça pisse le sang. Quand on cherche le lobe pour emmener Karl à l’hôpital, pour le recoudre, on ne le trouve pas. Il n’y a que le malabar clair qui colle, dans les herbes. Joël l’oncle dit que c’est peut-être bien le chien Tania qui l’a bouffée, l’oreille, que ça ne l’étonnerait pas. Elle engloutit n’importe quoi. Pierre n’en revient pas d’avoir bondi comme ça. Tout gros tas, tout doux qu’il est. La force décuplée, la vitesse intersidérale, les dents qui s’agrippent et qui mordent et qui déchirent. Il refait le film. Devant le tipi en branchages, la cabane, assis sur le rocher au lézard, il bricole son arc. Il fait chaud. Il sue. Il mâchouille. Il agite parfois la main pour faire déguerpir les mouches. Il ne voit pas son frère aîné arriver. Ce qu’il aperçoit d’un coup (image immobile, cadrage parfait, seconde subliminale), c’est son avant-bras bronzé, quand il chope l’arc. Karl recule de trois pas, le toise sans un mot. Son débardeur en lycra brille, sous le soleil. Ses mains d’insecte cassent l’engin en bois d’un coup sec sur sa cuisse maigre prestement levée. Crac. Dans le silence grouillant de l’été, le bruit est assourdissant. Pierre se rue alors sur lui sans rien penser, sans rien vouloir. Il se planque dans un buisson quand Joël déboule, alerté par le cri. Il a un goût acide dans la bouche. Son estomac se contracte sous les plis. Il vomit. (Et le fragment d’oreille, sous une feuille, dévoré minutieusement par les fourmis rousses).
Y a deux soleils. Ronds et secs, circonférence exacte. Rien qui bave, rien qui darde. Deux soleils au-dessus de Limoges. Deux soleils au-dessus du garage devant lequel il se tient, engoncé dans trois pulls de laine, un bonnet et un gros blouson kaki. La porte est ouverte, l’intérieur sombre. Dans son dos se tapit une BMW 318i de 1987, verdâtre, au repos. Le siège avant allongé au maximum, encombré de couvertures et d’un duvet. La lumière d’hiver le plante sur place. Il baisse la tête, ferme les yeux, appuie le bout de ses doigts sur les paupières, presse fortement jusqu’aux myriades de filaments rouges, sur du noir. Quand il se redresse et les regarde en face sans ciller, il n’en reste qu’un. Un soleil. Un soleil au-dessus de Limoges, d’un garage, d’un type qui a froid. Deux rangées de portes blanches encadrées par du ciment se font face. Toutes fermées, sauf une. Il est seul et attend que le café monte ; s’accroupit et approche ses mains du réchaud. Il boit, souffle de l’air blanc, boit, souffle encore, sort le duvet, les couvertures, les secoue, plie, rabat. Au passage il effleure la voiture, la caresse. Il dispose à l’extérieur les trois cartons du fond, numérotés de 1 à 3. Devant les chiffres a été ajouté le mot : VIE. VIE 1. VIE 2. VIE 3. Il les ouvre, regarde à l’intérieur, mais sans aller plus loin. Il regarde, c’est tout. Un long moment à regarder. Ciel bleu délavé, pas un nuage. Tout se découpe parfaitement. Les graviers sur le sol, ses godasses noires, les bouts élimés de son jean sale, les boîtes alignées. Il les place dans le coffre, sort la voiture, referme la porte coulissante et roule vers la sortie de l’impasse. Quand il s’engouffre dans le centre, il est déjà dix heures. Des gens en manteaux longs se pressent sous les guirlandes électriques. Des bambins emmitouflés dans les poussettes, des vieux poussifs, bouches ouvertes à déglutir péniblement les froidures. Klaxons et grondements divers. À l’agence immobilière il rend la clef, règle en liquide la dernière mensualité due pour le garage. La fille derrière le comptoir a les paupières lourdes et de l’orange fissuré sur les lèvres. Elle clique et lui souhaite un joyeux Noël. Il répond de même. Il marche dans les rues, s’attarde, observe des gamins qui jouent près d’une poubelle avec un arc cassé. Quelques déchets débordent. Les enfants rient et s’invectivent, puis ils se lassent et partent en courant. Il s’approche, fait craquer des pots de yaourts vides, ramasse l’arc en plastique rouge, et l’unique flèche. Plus loin, devant un magasin de jouets, des bénévoles du Secours Populaire emballent des cadeaux. De grandes boîtes. L’homme demande du scotch, pour réparer la courbe cassée, puis s’il peut faire emballer l’arc et la flèche. Ce n’est pas une grande boîte, et ça n’a manifestement pas été acheté là derrière. Le papier est laid de toute façon mais le type s’énerve, putain mais c’est quoi cette bienfaisance à la con. On s’excuse de chaque côté, l’arc et la flèche sont joliment emballés en longueur, il y a même un ruban en tortillon et un joyeux Noël, pour finir. Il file à grandes enjambées, se jette dans la voiture, démarre.
Chez Sabine il ne trouve rien à dire. Il lui tend le cadeau et manque préciser, pour Angèle, puis il se ravise et ne donne rien. Dans le fond, par l’ouverture, il voit le sapin avec des trucs moches dessus. Ça brille, ça sent bon, ça sent bon le chocolat dans la cuisine étroite dans laquelle ils se font face. Le bas du dos de Sabine s’appuie contre l’évier. Lui se tient debout, collé à la fenêtre. Il sent la chaleur du radiateur s’infiltrer sous les couches de vêtements, une douce tiédeur qui ramollit. Il pose le paquet par terre. Il ne s’attarde pas sur la rondeur ostensible de son ventre.– Alors tu t’en vas, Karl ?
Sa voix à elle est douce, ses bras tombent le long de son corps, et rien ne dit qu’elle est hostile, rien ne dit qu’elle lui en veut de certaines choses. Il y a deux ans, déjà, qu’ils se sont dits (plus possible, pas comme ça, bref, la longue litanie de l’impossibilité de l’amour).– Ouais. Ils se regardent. Se sourient presque.
– Je m’en sors plus trop, là. Je dois du fric, pas mal de fric, enfin tu vois, mes conneries habituelles. Elle attend, écoute.
– Je retourne là-bas. Chez eux. Je sais pas. Elle s’assoit au bord de la table, pose les coudes et entoure le bas de son visage de ses mains. Il s’assoit à l’autre bout, effleure de ses doigts les petites fleurs jaunes de la toile cirée et le trou de cigarette. Elle dit tu verras bien, faut faire comme tu le sens. Ils seront sûrement contents de te voir, depuis le temps. Ils t’aideront. Il dit oui, mais une teneur de oui faible, incertaine.
– Tu sais j’arrête pas de penser à un truc. Elle touche ses cheveux comme pour se recoiffer, rassembler des mèches, et remet sa main en place sans le faire. C’est ce truc qui m’obsédait avant de partir, quand j’étais petit. Je savais qu’il y avait là-bas et le reste du monde, et je me demandais comment on faisait pour y aller, dans le reste du monde. Je voulais tellement… T’as un verre d’eau ? Il boit d’un trait.
– Ben je sais toujours pas. Pourtant ça fait plus de vingt ans, merde, plus de vingt ans que je me suis tiré. Il parle si doucement qu’elle croit qu’il va chialer, mais il se met à rire et s’interrompt. Il n’entend pas la porte d’entrée s’ouvrir et se refermer. Soudain il y a Angèle dans l’encadrement, ses yeux noirs, ses cheveux courts frisés de punkette de cinq ans. Derrière, un grand type sympathique au sourire trop large engoncé dans un anorak bleu, le genre impossible à détester. Ils se saluent presque cordialement, et Karl serre sa petite fille dans les bras, très fort, même s’il pue et qu’il pique et qu’il n’est même pas foutu d’acheter des grandes boîtes carrées. Il lui murmure des choses secrètes à l’oreille. Ses yeux à elle étincèlent et elle avale tout goulûment. Thierry s’est retiré avec élégance, il mate la télé et ils sont à présent tous les trois dans la cuisine, à des hauteurs variables. Leurs corps frémissent. Il y a du silence et des yeux qui oscillent entre les pudeurs. Angèle ne dit rien et c’est normal, elle ne dit jamais rien avec des mots.
Karl les embrasse toutes les deux : l’odeur un peu sucrée de Sabine, le musc léger du cou si frêle d’Angèle. Il lui dit qu’il ne va pas très loin, qu’il retourne vers sa famille à lui, qui est aussi la sienne, même si elle ne la connaît pas encore. Il dit qu’il reviendra bientôt la voir, ou la chercher, pour passer du temps avec elle. Toi et moi. Comme toujours. Comme avant. C’est seulement quand il part, au moment du vague signe de la main à Thierry, juste avant de franchir la porte, le paquet sous le bras, qu’il se met à trembler. Dehors, froid et sec, un soleil, il est temps pour la ville devenue hostile de l’éjecter proprement.
- Séverine Chevalier au festival et salon du livre de Caen, Époque Le 28 mai 2026
Du 28 au 31 mai, retrouvez Séverine Chevalier à l’édition 2026 du festival et salon du livre de Caen, Époque.
Documents à téléchargerDocuments à télécharger