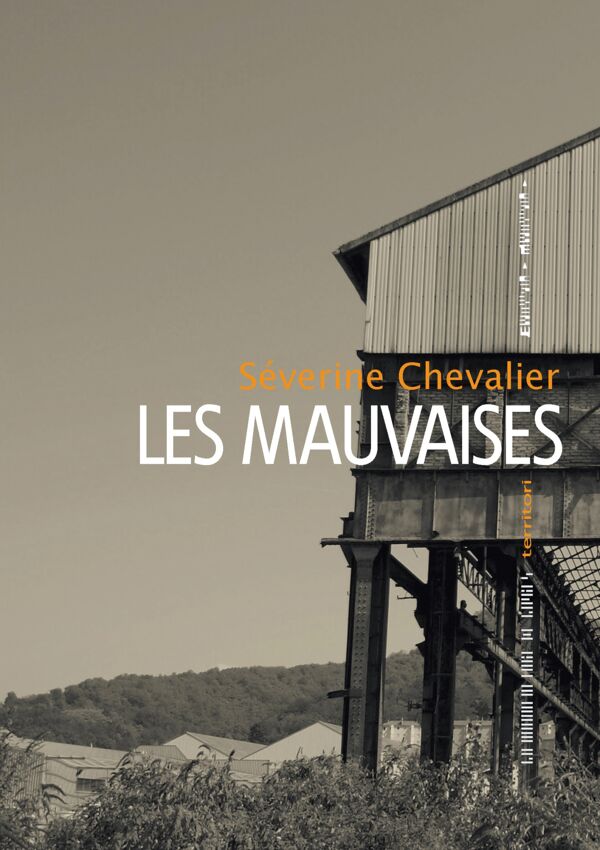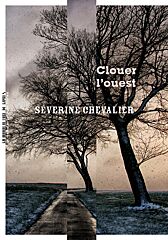Séverine Chevalier
Les Mauvaises
Roman
192 pages
a paru le 8 février 2018
ISBN 978-2-3588-7245-4
Roman
192 pages
a paru le 8 février 2018
ISBN 978-2-3588-7245-4
Deux jeunes filles d’une quinzaine d’années et un petit garçon aiment à s’aventurer dans une forêt du Massif central, au bord d’un lac qui vient d’être vidé. Autour d’eux, les adultes vaquent à leur existence, égarés, tous marqués de séquelles plus ou moins vives et irréversibles. Il y a les anciens, ceux qui sont nés ici, aux abords des volcans d’Auvergne. Il y a les moins anciens, il y a les très jeunes, puis ceux qui viennent d’ailleurs. Il y a aussi ceux qui sont partis, ont tout abandonné, et dont les traces subsistent dans les esprits. Une des deux jeunes filles est retrouvée morte, puis c’est sa dépouille à la morgue qui disparaît en pleine nuit…
Les Mauvaises dresse deux paysages infiniment blessés : celui des volcans où l’on déboise intensivement les forêts et où l’on vit dans les vestiges de l’ère industrielle ; celui des hommes et des femmes qui se trouvent ici, enracinés ou parachutés au hasard. Blessures et drames se succèdent ainsi sous la plume rigoureuse de l’auteur de Clouer l’Ouest, façonnés sous la forme de courts épisodes où le poids des mots agit comme un venin très lent, mais redoutable.
- Revue de presseChaque mot est presque irremplaçable, à sa juste place, modeste signifiant ouvrant sur un luxe de sensations et d’émotions pour le lecteur.Les Mauvaises est assurément un texte magistral. Brillantissime.
- téléchargez l’extrait80’sjeudi 11 août 1988Sainte ClaireLe cadavre disparut la même nuit que les bêtes. Une nuit d’été bien noire, sans lune ni ombre, touffue et épaissie de nuages stériles. Personne pour voir, pour entendre, pour se faire une idée précise de ce qui se tramait. On somnolait, tournant et retournant dans les lits moites, s’accommodant plus ou moins de la chaleur poisseuse de la nuit estivale, rêvant mal. Certains se relevaient malgré tout pour fumer, se brûlant presque la langue, exaspérés par la torpeur de la nuit chaude et les idées violentes, des flashs de mort brutale trouant le ciel pire que les étoiles filantes qu’on ne décelait pas, avec les nuages écrans.On ne faisait aucun vœu, on tremblait plutôt, craignant le pire par contagion.Même ici, aux alentours de huit cent mètres, en surplomb de la grande plaine où les températures s’avéraient parfois bien pires, même ici les hommes et les bestiaux souffraient du soleil sec et dur et de l’absence de pluie, de vent ; malgré les arbres, les gorges, les mamelons herbeux et les collines, les falaises, les forêts déployées, les rivières et leurs méandres, les lacs, les bocages, les fermes et les maisons aux pierres épaisses et grises spécialement érigées, à l’époque, pour se protéger de l’hiver, et qui d’habitude défendaient aussi les corps contre les touffeurs usuelles de l’été.Dans les bistrots, les patelins, on commençait à penser à la terre sur laquelle on vivait comme s’il existait un lien, ou, au moins, un écho lointain entre cette chaleur soudaine, extravagante, et le magma, les cratères, les éruptions anciennes dont le territoire avait fait l’objet, il y a longtemps.On s’en préoccupa vaguement, comme certaines pensées flottent et gangrènent l’esprit bien qu’on tente de les remiser dans un coin, et qu’on fanfaronne pour rigoler, faire diversion, accoudé au zinc, buvant un petit blanc en égrenant affaires en cours et autres bazars ancestraux.Il y eut ce matin-là l’employé de la chambre funéraire, curieusement érigée en plein milieu des champs et des arbres et des vaches, à équidistance de deux hameaux du village de M., qui gara sa 4L sur le côté, passa les deux colonnes à la grecque dont l’une qu’il effleura avec sa main droite, comme chaquematin, ouvrit la porte vitrée décorée de tiges vertes, sous le panneau De dignes obsèques avec Pascal Pelaut, alluma les lampes spécialement tamisées, appuya sur le bouton de la chaîne hi-fi pour lancer d’ores et déjà la musique douce, la douce, douce musique pour les vivants qui viennent visiter les morts avant que d’autres ne les enfouissent ou ne les brûlent.Il avait mal au ventre et marre, pour une fois, marre de veiller les défunts, même elle, la si délicieuse, la si maigre, la si mignonne poupée qu’il aurait pu embrasser sa bouche blanche et froide ou son cou mince marqué en diagonale par la corde, s’il avait osé.Il ne vit pas tout de suite la vitre du local technique, brisée, les portes intérieures ouvertes.Il ne sut pas qu’un renard, vers minuit onze, après le rapt du corps, se coula aux interstices, creva la poubelle que l’employé avait oublié de vider, et se reput des quelques os de poulet de son déjeuner de la veille.Il ne savait pas non plus qu’ailleurs, loin, dans des lieux auxquels il n’avait seulement jamais pensé, dans des villes gigantesques où il n’irait jamais, des hordes de ces mêmes bestioles prospéraient en douce, bouffant et déchiquetant hamburgers et déchets laissés par les hommes.Il y avait trois corps, normalement : deux hommes vieux, une fille jeune, autour de quinze ans, déposée la veille, chacun étendu et préparé dans une pièce individuelle, le salon privé comme disait le patron, mais il n’en restait plus que deux. Deux âgés, l’ordre des choses, même si l’un d’eux creva bêtement sous un soleil d’acier, écrasé en bas d’une pente par un tracteur dernier cri qu’il venait juste de finir de rembourser. Une erreur, une funeste inattention.Avant de rentrer dans la troisième chambre, lumière tamisée, musique suave, faux ficus plus vrai que nature posé dans un coin, sur le sol, il pensa fugacement qu’il pourrait se coucher sur elle, juste une minute, s’allonger délicatement et personne ne le verrait et il en avait bien le droit, une sorte d’hommage à la jeunesse morte, et peut-être cela soulagerait son bide tendu, dur, viscères nouées comme du bois, si douloureux que son père et sa mère vieillissants s’inquiétaient. Ils l’entendaient hurler, la nuit, mais peut-être étaient-ce des cauchemars, peut-être fallait-il le payer un peu de toujours frayer avec les morts, au lieu de s’occuper des vivants.Une fois pourtant, il avait eu une femme. Il vécut même avec elle quelques temps, au village, juste à côté de chez sa soeur, derrière la mairie. Il ne souffrait pas du ventre, à cette époque. Il aimait regarder ses yeux noirs, se frotter à ses joues épaisses.Quand elle était morte il ne s’en était pas rendu compte car elle ne parlait pas beaucoup.Pendant un jour et une nuit entière il resta à ses côtés, dans le fauteuil en velours à grosses côtes marron qu’on peut balancer vers l’arrière, attendant simplement qu’elle se réveille et secoue la tête, en clignant des yeux, réclamant un café avec beaucoup de lait.Elle aimait ça, le café au lait ; ça ne l’écoeurait pas. Elle se fatiguait vite, dormait beaucoup, alors il ne s’était pas vraiment inquiété, d’autant qu’il vivait avec la certitude étrange que non seulement elle ne l’abandonnerait pas, mais qu’elle ne mourrait jamais, non plus.Ce fut la frangine, apportant comme chaque matin le journal, bondissante et frisottée, qui, se penchant vers elle, se releva et dit, mais elle est morte Francine, bon sang. Elle appela le docteur, s’occupa de tout vite et bien comme elle savait faire, sans mots inutiles, efficace, et il rentra chez les parents, au hameau.Depuis, il avait trouvé ce travail, et le patron était des plus corrects, presque gentil parfois ; il ne le laissait pas accueillir les clients, les familles éplorées, et cela lui convenait car il n’aurait pas su quoi leur dire, ni comment ou pourquoi compatir.En ce sens, les morts lui allaient bien.Pas besoin de composer, de se triturer l’esprit ou les mains pour savoir quoi faire, comment se comporter. Ils vous acceptaient comme vous êtes, maladroit, malhabile, impuissant, plus tolérants et magnanimes encore que les animaux.Il ne la connaissait pas vraiment, Micheline Broume, dite Roberto. Il ne savait pas pourquoi on la surnommait ainsi, d’un nom d’homme, de musculature italienne et luisante − il imaginait ; alors qu’elle semblait si frêle, aussi joliment minuscule que la porcelaine de sa mère, la danseuse au teint livide et au tutu rose, la jambe gracieusement levée vers le ciel, sur le buffet de la cuisine, à côté des factures.À peine la voyait-il passer parfois, toute droite sur sa mobylette orange, walkman sur les oreilles, comme il lui arrivait de voir de loin, sur les chemins, dans les prés, le chevreuil à trois pattes que même les chasseurs évitaient de tuer.Il savait juste qu’elle était la fille de Lipo, la petite-fille de Bébé, que sa mère était partie quand elle était toute petite, enfin une fille du pays comme une autre. Il ne s’occupait pas trop des jeunes, il vivait parmi les vieux et les morts.Il ne savait pas qu’on parlait d’elle comme d’une petite salope, à vagabonder et coucher avec n’importe qui, y compris la bande à Ludo, ces jeunes qui tiraient sur tout ce qui bouge, ivres morts, quand c’était la période de la chasse, sans se soucier de rien.Une fois, ils avaient même buté un chat.Et aussi le marginal installé depuis peu, Fortuna Moureau, squattant impunément une des maisons des ingénieurs abandonnée, sans que le Maire ou quiconque ne fasse rien, ne le force à partir.Il ne savait pas non plus qu’elle traînait avec la sauvage, et le garçon fou.Ceux qui la traitaient de pute, pour la plupart, avaient enfoncé leurs bites dans sa bouche, leurs vieilles bites molles, ou dures, selon l’âge et des considérations physiologiques indépendantes de la volonté, qui dans leur bagnole, qui dans les toilettes du bar des Tilleuls, qui lors d’un bal de village finissant la plupart du temps en baston, pour des motifs immédiatement oubliés par les protagonistes.Elle avait la bouche précise, une sorte de savoir-faire, rentrait bien les dents, goûtait les vieux gars mariés ou célibataires et les jeunes foutraques et ils aimaient imaginer ses petits seins tremblants qu’elle ne montrait presque jamais, sauf à Fortuna, la dernière fois, par exemple, quand elle avait marché nue sur le fil d’entraînement et que le soleil l’éclairait implacablement.Elle se découpait sur les arbres, fine et subtile, et il aurait pu l’aimer s’il avait pu aimer tout court.L’employé savait juste qu’une touriste l’avait retrouvée pendue au viaduc, en aval du barrage, à cent trente mètres de hauteur au-dessus du filet d’eau de la rivière, après la retenue.Quand il entra dans la chambre dédiée à la jeune fille, ça sentait l’aigre et la vanille et autre chose, mais il ne sut pas quoi. Il s’apprêtait à murmurer bonjour, Micheline, comme il les saluait à chaque fois, en penchant la tête, familièrement mais avec déférence et pas trop fort, les morts. Seulement il n’y avait plus de corps, de poignets fins, d’ongles rongés, de mains crevassées et sèches sur le dessus, abîmées par les produits du salon de coiffure.Plus rien qu’un cercueil ouvert, béant, entre deux candélabres et un bouquet de fleurs blanches, presque déjà fanées.Il n’y avait plus d’animaux non plus, au lieu-dit Le Creux, ce matin-là, quand les services de protection animale débarquèrent, assistés par la gendarmerie, dans l’exploitation agricole.Le convoi avait franchi le barrage, foncé sous le viaduc auquel la robe en éponge orange s’était accrochée puis délicatement balancée, deux jours plus tôt, et tourné et tourné encore sur la route étroite longeant par instants les rails et traversant la forêt, avant d’investir l’endroit. Tout était vide.Seuls subsistaient l’odeur, les abris sales, le camion et un bus déglingués au milieu d’un pré, sous le soleil aigu qui commençait à poindre. Et quelques charognes, dévorées par les mouches avides dont le bourdonnement donnait envie de vomir.Les trois cent soixante animaux maltraités avaient disparu avec leur propriétaire, un type louche dont on disait qu’il avait déjà été condamné pour trafic de viande de cheval, et que personne ne connaissait vraiment, dans le coin.Le voisinage s’était plaint de la divagation de certains animaux, des cris de moutons et de chèvres provenant du camion et du bus. Les services de l’État et les associations dépêchées sur place les avaient vus : des chèvres et des vaches maigres à faire peur, vivant dans des abris de tôle puants ; des ânes et chevaux étiques ; un mouton, arrière-train brisé, pattes et cou entravés par des cordes, dans le camion.Des lettres recommandées, des arrêtés valant mise en demeure de remédier à la situation furent envoyées. En vain.Et le type avait fini par se barrer. Et le soleil brilla un peu plus encore, tandis que le vétérinaire procédait à l’euthanasie du mouton qui était resté prisonnier, seul, déjà silencieux, ses yeux ourlés de rose dans le vide, les cils blancs et clairsemés, très loin des prés, de l’herbe jaune, du ciel limpide des tropbeaux jours.Car ce qu’il y a, pensa soudain le jeune véto, avec les animaux et les très petits ou très vieux humains, et tous ceux qui ne peuvent parler de façon intelligible, c’est qu’on peut très bien ne pas entendre la plainte. Aucun registre ne s’ouvre alors pour prendre acte des faits, des préjudices irréversibles, des souffrances sans fin.Ainsi, ça n’est rien ; quand il n’y a pas d’histoires, pas de récits, rien n’existe. RIEN.Bien qu’aucun lien ne fut formellement établi entre ces deux disparitions, bien qu’il n’y eut apparemment aucune correspondance entre une jeune fille suicidée et une cohorte d’animaux maltraités, si ce n’est leur occultation subite, la concomitance de la découverte des faits fit parler, conjecturer, se répandre en hypothèses et suppositions, éclipsant ainsi l’histoire de la chaleur intempestive.À la boulangerie, au café, devant et dans l’église, dans les fermes, les champs où on faisait les foins, les pas de porte, les chemins, ça causait.Les silences aussi comptaient. On n’en pensait pas moins, même sans rien dire, et on hochait la tête, ou on levait et raclait les yeux au ciel. Parfois on s’inclinait légèrement, comme acceptant la fatalité ; ou on haussait les épaules, histoire de dire que ça devait sans doute arriver.Certains allaient jusqu’à imaginer que le type bizarre venu d’ailleurs, le maquignon, non seulement s’était enfui avec les animaux, ses spectres, mais qu’il avait embarqué la petite morte, pour on ne savait quelle cérémonie démoniaque, occulte, à fomenter en secret les nuits de pleine lune, sur quelques montagnes proches, ou autres volcans éteints.Les uns ne pouvaient s’empêcher de considérer que la fille était coupable, car comment pouvait-on infliger tant de mal à ceux qui restent, comment pouvait-on, par ce double geste si fondamentalement égoïste, ne pas songer à eux ?Les mères surtout étaient effondrées. Elles serraient leurs enfants contre elles, regardaient en coin leurs adolescents poussés trop vite, leurs grands bras et leurs jambes étirées d’araignées, espérant que leur mutisme ne voulait rien dire, qu’il ne présageait rien de désespérant qu’elles n’auraient su déceler, elles qui pensaient tout savoir, tout interpréter, être capables de tout prévenir, malgré l’insondable mystère de l’adolescence, son horrible agitation, les duretés, les maris indifférents, les chaleurs, la crise, les taloches, la vie qui va et qui vient et qui n’épargne personne.Car non seulement elle s’était tuée, la petite Roberto, mais il fallait encore qu’elle disparaisse.D’autres pensaient au père, à Lipo, et au grand-père, Bébé, des enfants issus de cette terre, des gens familiers que tout le monde connaissait et respectaient, et on se réjouissait secrètement de ne pas les croiser, car que leur dire, que manifester, que montrer d’adéquat et de juste face à la souffrance, non seulement du suicide d’une enfant ou d’une petite-fille, mais encore de la privation d’un corps mort, béance dont on craignait qu’elle empêche, qu’elle interdise les deuils.Chacun sentait qu’il y avait là quelque chose qui redoublait l’horreur, bien que le corps mort, à disposition, ne ferait rien de plus ; qu’il ne rétablirait aucune vie ; qu’il ne produirait aucun retour arrière, ce moment fantasmé où ceux qui restent peuvent penser et si j’avais dit, et si j’avais fait, alors tout auraitchangé, le pire étant que c’était sans doute vrai, même seulement pour reporter le moment.Et Roberto se tiendrait là, efflanquée et virevoltante, dans la lumière terrible d’août, et il n’y aurait pas, alors, à se confire de chagrin.
Rencontres
- Séverine Chevalier au festival et salon du livre de Caen, Époque Le 28 mai 2026
Du 28 au 31 mai, retrouvez Séverine Chevalier à l’édition 2026 du festival et salon du livre de Caen, Époque.
Documents à téléchargerDocuments à télécharger